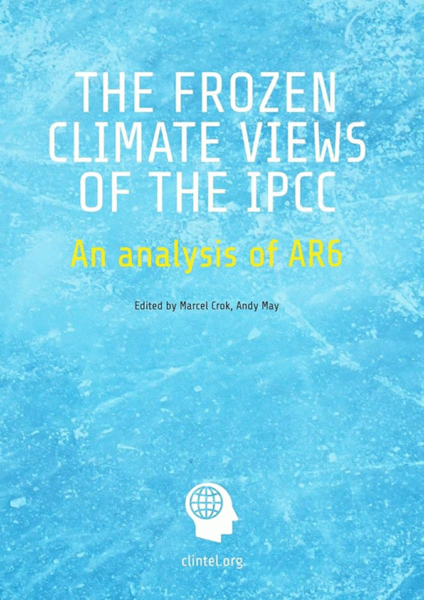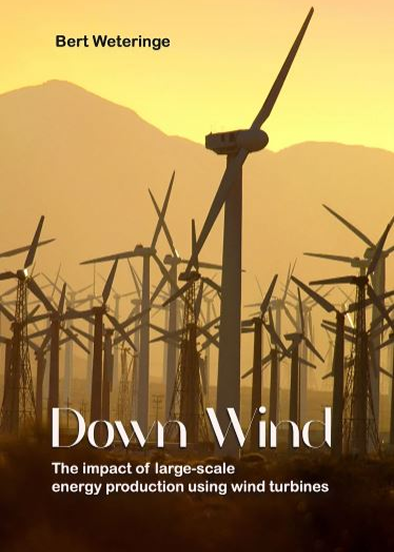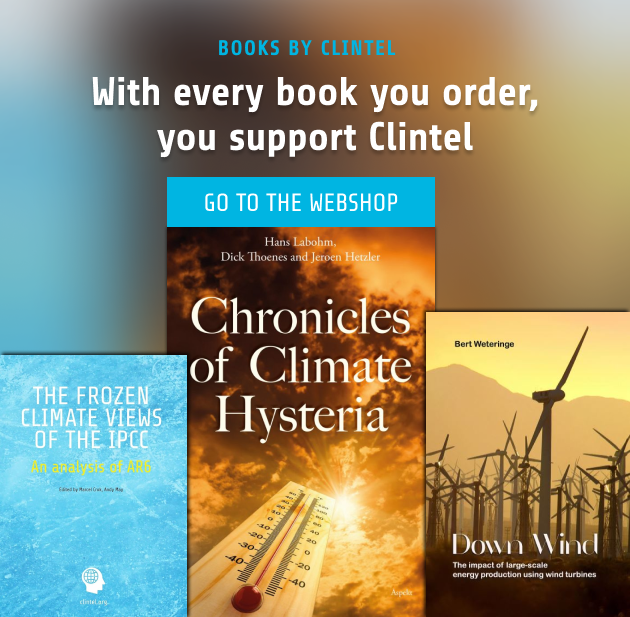La menace chinoise nécessite une politique énergétique idéologiquement libre
Que la menace de la Chine de restreindre les exportations de minéraux de terres rares se matérialise ou soit résolue par des négociations commerciales, cet épisode souligne la fragilité des chaînes d’approvisionnement américaines et l’importance de développer des sources nationales.
Cela est particulièrement évident dans le secteur de l’énergie, où les politiques climatiques ont rendu des dizaines de pays plus dépendants que jamais des importations. L’adhésion à l’orthodoxie climatique a exposé à maintes reprises les pays à des risques évitables, démontrant à chaque fois le coût de la subordination de l’utilité réelle à la pseudoscience de modèles théoriques et a l’arnaque d’intérêts particuliers.
La réorganisation des flux mondiaux de pétrole et de charbon après 2022 a révélé l’absurdité du programme anti-combustibles-fossiles. Les pays européens, menés par l’Allemagne et le Royaume-Uni, se sont lancés dans une élimination progressive et radicale des combustibles fossiles, démantelant leurs centrales à charbon et réduisant leur production nationale de gaz naturel au profit de l’éolien et du solaire. La production nationale d’hydrocarbures s’est effondrée et la dépendance aux importations d’énergie a explosé, notamment pour les Allemands et les Britanniques.
Alors que l’Europe se détournait du charbon russe, elle s’est empressée d’acheter ce combustible aux États-Unis, au Qatar et en Afrique, souvent à des prix bien plus élevés. Le charbon que l’Allemagne importait autrefois de Russie a été remplacé par du combustible expédié depuis des régions plus lointaines, compromettant ainsi les prétendues « économies de carbone » de sa politique climatique. Lorsque le gazoduc russe a été détruit pour cause de guerre, l’Europe s’est retrouvée dépendante des livraisons de GNL (gaz naturel liquéfié) en provenance des États-Unis, à un coût deux fois plus élevé.
Les obstacles bureaucratiques au redémarrage des centrales à charbon et à gaz ont encore aggravé les pénuries, faisant grimper les coûts de production et de chauffage des ménages. Les secteurs à forte intensité énergétique – acier, aluminium, engrais – ont fermé leur portes ou ont délocalisé leurs activités vers des pays où l’électricité est plus fiable et plus abordable, notamment les États-Unis et l’Inde.
Aux États-Unis, les politiques fédérales axées sur le climat ont créé de nouveaux obstacles. La loi de réduction de l’inflation de l’administration Biden a injecté des milliards dans les énergies renouvelables et a imposé des restrictions sur le forage offshore et la construction de pipelines. La résilience de la chaîne d’approvisionnement a été mise à mal par la marginalisation idéologique des carburants abondants et bon marché.
Pourquoi une nation échangerait-elle volontairement une énergie domestique résiliente contre des sources d’énergie peu fiables, vouées à ne pas répondre aux besoins quotidiens de ses citoyens et susceptibles de défaillances désastreuses en cas de crise ? Comment les décideurs politiques peuvent-ils justifier le fait d’imposer des coûts énergétiques gonflés à des industries entières pour se conformer à des politiques de « zéro émission nette » fondées sur des vœux pieux et une rhétorique creuse ? Pour certains, la réponse réside dans la pureté idéologique et une confusion mentale, et pour d’autres, une course cynique vers le pouvoir et l’argent.
Chaque mégawatt de production d’énergie nationale mis en veilleuse dans la poursuite d’objectifs climatiques représente une vulnérabilité future qui se matérialise non pas par des livres blancs, mais par des privations tangibles pour les populations.
Les pays dotés de mandats stricts en matière d’énergie « verte » ont été les moins bien lotis lors de perturbations; ceux disposant de réseaux électriques diversifiés, basés sur les énergies fossiles, ont rebondi plus rapidement.
Les pays qui ont continué d’investir dans les combustibles fossiles, comme l’Inde et l’Indonésie, ont obtenu de bien meilleurs résultats. Alors que l’Europe souffrait du coût élevé de l’électricité, l’Inde a accéléré sa production de charbon, a augmenté ses capacités de raffinage et a signé des accords de GNL à long terme. L’Indonésie a exploité ses ressources en charbon et en pétrole, pour stabiliser son approvisionnement énergétique national et protéger ses consommateurs de la volatilité mondiale.
Ces exemples prouvent que le pragmatisme énergétique, et non l’idéologie, préserve les intérêts nationaux. L’échec de l’expérience « zéro émission nette » réside dans son détachement de la réalité physique. Les combustibles fossiles demeurent le fondement de la civilisation moderne : ils alimentent les transports, l’agriculture, la défense, l’industrie manufacturière, les technologies numériques, et bien plus encore.
Les gouvernements doivent abroger le labyrinthe réglementaire qui entrave l’exploration pétrolière et gazière et l’extraction du charbon sur le territoire national. Ils doivent accélérer l’approbation de pipelines, de raffineries et de terminaux d’exportation de GNL. Ils doivent mettre fin aux subventions colossales qui soutiennent des technologies peu fiables et permettre aux sources d’énergie d’être compétitives en termes de coûts et de fiabilité.
Les investissements doivent être orientés vers le développement de technologies avancées d’exploitation des combustibles fossiles, telles que les centrales à charbon à haut rendement et à faibles émissions, capables de fournir une énergie propre sans compromettre la fiabilité. Parallèlement, la réglementation irrationnelle du nucléaire doit être remplacée par une vision lucide des avantages considérables et des risques gérables de cette technologie.
En fin de compte, l’indépendance énergétique n’est pas seulement une question économique ; elle constitue le fondement de la souveraineté nationale. Une nation qui n’est pas en mesure d’alimenter ses foyers, de fournir ses industries et de transporter son armée n’est pas indépendante. C’est une nation à la merci des autres. À l’ère de la concurrence exacerbée entre les grandes puissances, externaliser sa sécurité énergétique constitue un acte de désarmement unilatéral.
Traduit par Eric Vieira

Vijay Jayaraj
Vijay Jayaraj est chercheur associé à la CO₂ Coalition, à Fairfax, en Virginie. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement de l’Université d’East Anglia, d’un diplôme de troisième cycle en gestion de l’énergie de l’Université Robert Gordon, toutes deux au Royaume-Uni, et d’une licence en ingénierie de l’Université Anna, en Inde.
more news
Climate change computer projections are manifestly false and dangerously misleading
The alleged threat to the planet from human caused climate change has been at the forefront of Australian politics over the recent half century. Every year, just before meetings of the UN Conference of the Parties (COP) to the Climate Change Convention, slight increases in atmospheric carbon dioxide and global temperature are portrayed in the media as harbingers of future doom. Every extreme weather event is made out to be an ill omen of what is to come unless fossil fuels are eliminated.
Glacier fluctuations don’t yet support recent anthropogenic warming
Holocene glacier records show that glaciers worldwide reached their greatest extent during the Little Ice Age and were generally smaller during earlier warm periods. While glacier length is a valuable long-term regional climate indicator, the evidence does not clearly support the idea of uniform, synchronous global warming.
Challenges to the CO2 Global Warming Hypothesis: (13) Global Warming Entirely from Declining Planetary Albedo
Is the recent warming the result of less reflection of sunlight by the Earth? Two researcher state that declining albedo — not CO₂ — dominates the temperature trend.