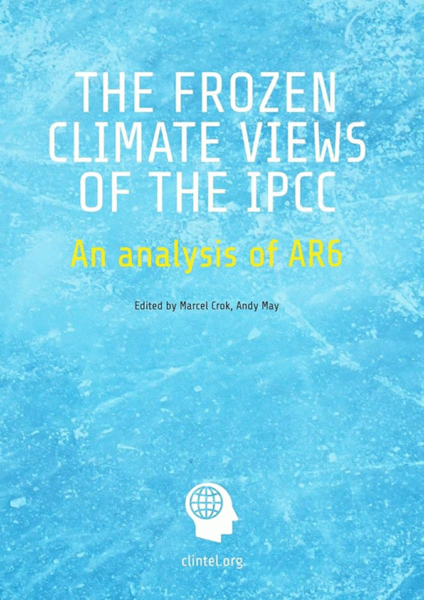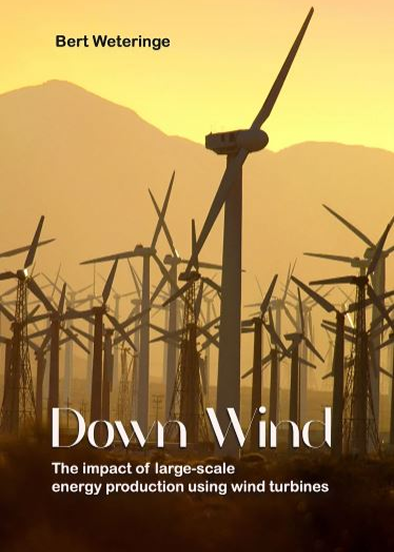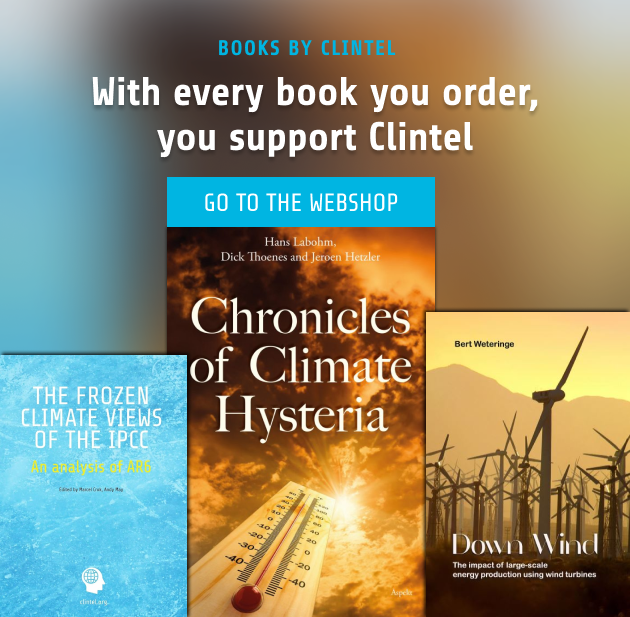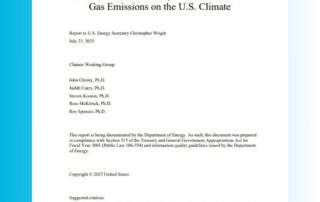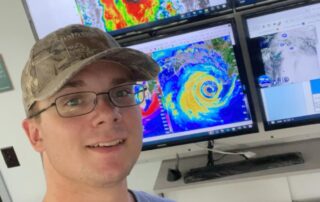Ross McKitrick parle des modèles climatiques, des impacts économiques et du rapport du DOE
Dans cet entretien approfondi, l’économiste et statisticien Ross McKitrick aborde les modèles climatiques, l’incertitude et la question de savoir si le débat public sur le climat est aussi scientifiquement équilibré qu’on le prétend souvent. Il revient également sur son rôle de co-auteur du récent rapport du département américain de l’Énergie (DOE).

LLe professeur Ross McKitrick, professeur titulaire d’économie et de finance
à l’Université de Guelph, dans Climate: The Movie
Manish Koirala
Date: 24 janvier 2026
Ross McKitrick est l’un des critiques les plus reconnus des conclusions de la science climatique dominante. Économiste canadien, il est professeur titulaire au Département d’économie et de finance de l’Université de Guelph, en Ontario, où il enseigne depuis 1996. Fort d’une solide formation en économétrie et en méthodes statistiques, il a mis ses compétences au service de l’analyse des données climatiques, des relevés de température et de la structure des modèles climatiques, suscitant souvent d’importants débats et controverses au sein de la communauté scientifique.
En dehors de ses fonctions universitaires, McKitrick est chercheur principal à l’Institut Fraser, un important groupe de réflexion canadien. Il est également affilié à la Global Warming Policy Foundation (GWPF) au Royaume-Uni, où il siège au conseil consultatif académique.
McKitrick s’est d’abord fait connaître du grand public en contestant la célèbre courbe en « crosse de hockey » des températures mondiales. Il a constamment questionné au sujet de la possibilité que les modèles climatiques dominants exagèrent les tendances au réchauffement.
Au milieu de l’année 2025, McKitrick a fait partie des cinq membres du Groupe de travail sur le climat (GTC), un groupe indépendant de scientifiques réuni par le département de l’Énergie des États-Unis. En juillet de la même année, le groupe a publié un rapport exhaustif de 150 pages visant à réexaminer les hypothèses classiques concernant les effets des émissions de gaz à effet de serre sur le climat américain.
1. Comment réagissez-vous aux allégations selon lesquelles le récent rapport du DOE, dont vous êtes co-auteur, aurait été produit pour « fabriquer un prétexte pour rejeter » les données scientifiques acceptées sur le changement climatique d’origine humaine et ses impacts ?
Notre rapport recoupe en grande partie celui du GIEC, et nous ne contestons pas les fondements scientifiques. On nous a précisément demandé un rapport qui examine certains sujets importants, souvent minimisés ou négligés dans le débat public. Nous ne nions pas, par exemple, que le CO2 soit un gaz à effet de serre. Nous ne nions pas non plus la réalité du changement climatique.
Nous examinons certains aspects en allant plus en détail. Par exemple, les modèles climatiques ont-ils tendance à surestimer le réchauffement ? Et nous apportons des preuves que, oui, c’est une tendance qui se confirme. Le CO2 est-il associé au verdissement de la planète et à une meilleure productivité agricole ? Eh oui, nous présentons de nombreuses preuves à ce sujet.
Nous abordons des aspects de la variabilité naturelle du climat souvent ignorés dans le débat public et minimisés par le GIEC. Notre objectif avec ce rapport est d’enrichir le débat public, non de le faire taire ou de discréditer la science du climat.
2. Dans quelle mesure avez-vous eu de l’autonomie pour façonner les principales conclusions du rapport par rapport à l’alignement sur les points de vue collectifs du groupe de travail sur le climat composé de cinq membres ?
Nous avions une autonomie totale. Au départ, nous pensions avoir un rôle à jouer dans le processus du constat de mise en danger, c’est-à-dire les conclusions de l’APE (administration de protection de l’environnement) concernant le constat de mise en danger de 2009. Mais on nous a tout de suite dit que nous n’étions pas concernés avec ça. Il s’agissait d’une équipe distincte. Nous n’avons eu aucun contact avec ce groupe. On nous a simplement dit de rédiger un rapport sur ce tout ce qui nous semblait important.
Et c’est ce que nous avons fait. Nous avons travaillé en groupe. Nous avons choisi les sujets à aborder, puis rédigé notre rapport. La première version a ensuite fait l’objet d’une évaluation interne au sein du Département de l’Énergie. Des scientifiques des laboratoires nationaux du Département de l’Énergie ont formulé des commentaires d’évaluation par les pairs. Nous avons révisé le rapport en conséquence. Mais nous n’avons subi aucun contrôle ni aucune directive politique de la part de l’administration.
3. Vous avez déclaré ne pas connaître les documents juridiques de l’APE, or ce rapport est désormais cité pour tenter de contester la conclusion de mise en danger. Dans quelle mesure êtes-vous à l’aise avec l’utilisation de ce rapport dans des contextes réglementaires et juridiques que vous n’avez pas contribué à élaborer ?
C’était une décision prise par le personnel de l’APE. S’ils nous avaient demandé notre avis, nous l’aurions sans doute donné. Mais nous avons publié le rapport pour que chacun puisse s’en servir.
Notre objectif était de présenter des arguments scientifiques et économiques que nous estimions valables et qui devraient être intégrés à tout débat sur le changement climatique. C’était notre but, et je pense que nous l’avons atteint.
4. Y a-t-il eu des réticences de votre part ou de vos co-auteurs concernant la portée ou la formulation ?
Bien sûr, nous avons échangé des brouillons ; parfois, nous étions facilement d’accord sur la formulation, et d’autres fois, nous n’étions pas d’accord et devions en discuter entre nous. Mais la version finale reflétait le travail de chacun d’entre nous, ligne par ligne, jusqu’à ce que nous parvenions à un consensus sur le texte.
5. Le rapport du ministère de l’Énergie a été critiqué pour avoir prétendument sélectionné des données de manière partiale et omis des travaux de recherche plus vastes. Comment avez-vous décidé quels ensembles de données et quelles études à inclure ou à exclure ? Et pourquoi le public devrait-il se fier à ces critères ?
Eh bien, je tiens à préciser d’abord que le rapport a été publié. Il s’agit d’un projet de rapport ; il a été soumis à la consultation publique. Nous savons donc qu’il y a certaines personnes de l’autre camp qui n’ont pas apprécié nos conclusions, et nous avons reçu des centaines de pages, et des dizaines de milliers de commentaires.
Malheureusement, des groupes environnementaux ont intenté une action en justice contre le ministère de l’Énergie, et une erreur de procédure s’est produite du côté de l’administration. Par conséquent, notre organisation n’avait pas été créée conformément à la loi fédérale sur les comités consultatifs, ce qui a entraîné la dissolution de notre groupe.
Nous avons examiné individuellement ces réponses, y compris les accusations de sélection biaisée ou de déformation des faits, et nous préparons actuellement nos notes et nos réponses. J’espère que nous pourrons bientôt présenter au public ce qui aurait normalement constitué la deuxième phase de ce travail : des réponses complètes à toutes les critiques, et une version révisée du rapport intégrant les corrections si nécessaires, ainsi que les contre-arguments à nos détracteurs.
Je peux donner un exemple. Concernant la question de la productivité agricole, les critiques avaient raison : notre rapport n’aborde pas l’impact des épisodes de chaleur extrême sur les cultures. C’était effectivement une omission ; nous aurions dû en parler. J’ai relu le document et pris des notes sur les points manquants. Cela ne change rien à la conclusion générale. Historiquement, les gains de productivité des cultures, dus en partie à la fertilisation au CO2, sont bien réels. Le constat général reste donc valable, mais il convient de rappeler que les acteurs du secteur agricole doivent renforcer leur résilience face à l’intensification des épisodes de chaleur extrême.
Voici un autre cas où, à mon avis, les critiques se trompent : nous affirmons que ce sont les modèles à faible sensibilité climatique qui reproduisent le mieux les données climatiques des 50 dernières années. Ils prétendent que nous avons examiné des études qui les confirment, mais ils nous en ont fourni d’autres qui, selon eux, les contredisent. J’ai examiné ces autres études, et en réalité, elles les confirment toutes. Je ne comprends pas pourquoi les critiques semblent croire que ces autres études aboutissent à une conclusion différente. Nous aurions pu utiliser n’importe laquelle des études qu’ils nous ont envoyées. Elles arrivent toutes à la même conclusion. La formulation finale peut varier, mais le constat est le même : le réchauffement de la surface et de la troposphère observé ces 50 dernières années est bien reproduit par les modèles à faible sensibilité climatique. Les modèles à haute sensibilité projettent un réchauffement excessif, et je pense que c’est une information cruciale pour ceux qui s’interrogent sur la conduite à tenir face à ces 40 modèles différents qui dressent des tableaux très divergents de l’avenir. Le fait que les modèles à faible sensibilité climatique reproduisent le mieux le passé récent est, à mon avis, une information importante.
6. Quand le deuxième rapport révisé doit-il être remis ?
Pour l’instant, il n’y a pas vraiment de calendrier précis. La situation — et cela peut paraître étrange ; Étant Canadien, les procédures judiciaires américaines me semblent très étranges — est la suivante : suite à une décision de justice, le ministère de l’Énergie a dissous le Groupe de travail sur le climat et s’est engagé auprès du tribunal, que nos travaux sont terminés, et nous respectons cette décision.
Ce que nous devons faire individuellement : nous restons libres d’écrire, de parler et de discuter du changement climatique. Nous cherchons donc simplement à déterminer individuellement la marche à suivre. J’espère qu’au début de cette année, nous pourrons achever ce travail et présenter une réponse complète aux principales critiques et réactions scientifiques que nous avons reçues. Je sais que les autres membres du groupe de travail étaient très enthousiastes à l’idée de le faire, car nous voulons évidemment défendre notre travail, mais aussi parce que certaines personnes ont consacré beaucoup d’efforts à l’analyse critique de notre rapport et méritent donc de voir un résultat constructif à la fin de ce processus.
7. Le groupe a-t-il tenté une quantification formelle de l’incertitude comparable aux méthodes utilisées dans le GIEC ou dans les évaluations climatiques nationales ?
Concernant les précipitations, John Christy et moi avions précédemment co-écrit un article utilisant des méthodes économétriques pour évaluer l’incertitude des tendances des moyennes et des extrêmes. Cette publication date d’environ cinq ans. Nous avons donc mis à jour l’ensemble des données, élargi la couverture géographique et en utilisant les mêmes méthodes issues de la littérature économétrique évaluée par les pairs.
De même, l’étude de l’écart entre les modèles et les observations dans la troposphère, travaux que John et moi avons publiés dans la littérature climatique, a été mise à jour pour les besoins du rapport afin de présenter les données les plus récentes. Toutefois, nous avons utilisé des ensembles de données publics et des méthodes économétriques standard ; nous n’avons développé aucune nouvelle méthodologie.
8. Si vous pouviez modifier une section du rapport en réponse aux nombreuses critiques scientifiques qu’elle a reçue, que changeriez-vous ?
Eh bien, je pense qu’à terme, lorsque nous publierons la version révisée, quelle que soit sa forme, et regardons cela : concernant les aspects économiques, l’une des critiques portait sur le fait que, lors de la présentation des résultats de la modélisation de l’évaluation intégrée de Nordhaus, j’avais insisté sur la proximité des températures entre le scénario sans réglementation et le scénario de réglementation optimale. Un critique a souligné que c’était vrai, mais que les trajectoires d’émissions divergeaient davantage que je ne l’avais évoqué ; j’aurais donc dû aborder ce point.
Il existe ensuite d’autres extensions à la modélisation de l’évaluation intégrée qui représentent plus formellement l’incertitude et l’aversion au risque. J’ai depuis assimilé ces informations et rédigé des synthèses là-dessus. C’est donc, une fois de plus, un exemple où les critiques ont soulevé des points pertinents. Nous avons abordé de nombreux sujets en seulement six semaines, il est donc impossible de tout couvrir. Cependant, certains ont souligné des éléments qui auraient dû figurer dans le rapport, et je pense qu’en fin de compte, les ajouts que nous avons faits en réponse aux critiques nous permettent d’aboutir à un rapport qui, à mon avis, remplit encore mieux notre objectif initial : élargir le débat sur le changement climatique et présenter une vision plus complète des enjeux au niveau des débats et ce que les données nous montrent.
9. Pourquoi le groupe n’a-t-il eu que six semaines pour travailler sur une question si importante ?
C’était hors de notre contrôle. Je pense que leur intention était claire : nous aurions été ravis d’avoir six mois à un an pour travailler dessus, mais c’était le mandat. Comme je l’ai dit, l’idée était la suivante : un projet serait publié, il y aurait une période de consultation publique, puis environ quatre mois seraient consacrés à l’analyse des commentaires, à la préparation d’un rapport révisé et à la réponse à toutes les critiques. L’ensemble du processus aurait donc duré jusqu’à un an. Le procès a tout chamboulé, et c’est pourquoi les choses ont semblé s’arrêter brutalement. Mais je crois qu’à l’origine, l’idée était que tout le processus – projet, commentaires, révisions – aurait été beaucoup plus long et plus lent si le groupe avait disposé de six mois ou d’un an.

Le professeur Ross McKitrick dans le documentaire primé de Martin Durkin, Climate: The Movie
10. À votre avis, quel aurait été le résultat du rapport si le groupe avait disposé de six mois ou plus pour le préparer ?
Nous aurions probablement conservé la même table des matières, dans la mesure où les sujets que nous souhaitions aborder restaient les mêmes. Un délai plus long nous aurait permis de consulter d’autres personnes, y compris celles qui sont devenues par la suite des critiques. Par ailleurs, il convient de noter que nous avons reçu de nombreux témoignages favorables à notre rapport et à notre approche sur ces questions.
Personnellement, sans cette action en justice, nous attendions avec impatience la phase de commentaires, d’examen et de révision. Lorsqu’on entreprend un projet d’une telle envergure, il est impossible de tout couvrir. C’est un vaste domaine, avec de nombreux experts, et bien sûr, certaines personnes maîtrisent bien mieux un sujet précis que nous tous. C’est donc à elles que nous souhaitions soumettre le sujet afin de recueillir leurs avis, qu’ils soient positifs ou négatifs.
Lorsque j’ai commencé ce projet, je savais que la publication du rapport initial ne représentait qu’une petite partie. L’essentiel consistait à traiter toutes les réactions, à gérer la période de consultation publique et les critiques professionnelles. C’est là que nous aboutirions au produit final que nous avions visé. Si nous avions eu plus de temps, cela n’aurait pas forcément donné un résultat idéal. La clé résidait vraiment dans le processus de commentaires et de révision, c’est-à-dire l’ensemble du processus d’évaluation par les pairs.
Ironie du sort, les groupes environnementaux qui ont poursuivi le ministère de l’Énergie reprochaient à notre rapport de ne pas avoir fait l’objet d’une évaluation par les pairs, comme ils l’estimaient nécessaire. Or, c’est précisément cette action en justice qui a empêché, jusqu’à présent, la finalisation de ce processus. Voilà l’un des effets pervers du système judiciaire.
Je pense que, dans les domaines où j’ai examiné les critiques et consulté la documentation que l’on nous a suggéré que nous aurions du aborder, notre message principal reste parfaitement valable et, dans certains cas, se trouve même renforcé. Nous pouvons désormais affirmer qu’il reflète non seulement l’opinion de nous cinq, mais aussi la sagesse d’une communauté plus large, incluant l’ensemble de la communauté de l’évaluation par les pairs.
11. Quelle est l’incompréhension la plus courante parmi vos détracteurs concernant ce que le rapport affirme réellement — et quelle est l’incompréhension la plus courante parmi vos partisans ?
L’affirmation que ce rapport est une attaque contre la science du climat —c’ est absurde. Quiconque lira attentivement le rapport comprendra qu’il ne s’agit pas d’une attaque contre la science du climat. Nous nous appuyons largement sur les rapports du GIEC et citons les rapports d’évaluation nationales du climat. Cependant, nous sommes également convaincus que certains sujets et débats importants sont minimisés ou ignorés et qu’ils mériteraient d’être abordés. C’est précisément notre objectif : enrichir et approfondir le débat, et non de le discréditer.
12. Pourquoi affirmez-vous que la loi américaine sur la qualité de l’air (Clean Air Act) ne constitue pas un bon cadre pour les politiques relatives aux gaz à effet de serre ?
Elle a été mise en place pour traiter les problèmes de pollution atmosphérique urbaine locale. Le cadre de la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act) divise le pays en zones de conformité et de non-conformité et autorise l’administrateur de l’Agence de protection de l’environnement (APE) à prescrire des normes d’émission locales pour les centrales électriques et les véhicules à moteur afin de faire passer les zones de non-conformité en zones de conformité, c’est-à-dire de réduire certains types de pollution atmosphérique à un niveau seuil. Ce cadre est totalement inadapté à un gaz à effet de serre présent sur l’ensemble du globe comme le dioxyde de carbone.
Il n’existe pas de zone de non-conformité ou de conformité pour le dioxyde de carbone. On parle d’un niveau uniforme qui se mélange jusqu’à la troposphère, et aucune réglementation applicable aux véhicules à moteur ou aux centrales électriques aux États-Unis ne saurait modifier unilatéralement la concentration mondiale de CO2, et encore moins le climat local. Par conséquent, si vous vous inquiétez d’un réchauffement excessif à Philadelphie, cela n’est pas lié aux voitures et aux centrales électriques de la région. Il s’agit d’un effet local d’un phénomène global.
C’est pourquoi la loi sur la qualité de l’air (Clean Air Act) – qui, à mon avis, n’étant pas juriste – a été mise en place pour lutter contre la pollution atmosphérique urbaine et s’est avérée très efficace à cet égard. Mais elle ne constitue pas un cadre d’analyse adapté au dioxyde de carbone et aux enjeux climatiques mondiaux.
13. Les modèles climatiques sont essentiels aux projections du GIEC, mais vous avez soulevé des inquiétudes quant à leurs limites. Dans quelle mesure pensez-vous que ces modèles, et les méthodes du GIEC pour quantifier l’incertitude, reflètent les risques réels des changements climatiques futurs ? Existe-t-il d’autres approches empiriques ou sources de données qui, selon vous, devraient jouer un rôle plus important ?
Je n’accorde pas beaucoup d’importance aux déclarations du GIEC concernant le niveau de confiance. Elles sont souvent très subjectives, et certaines sont même incohérentes. Par exemple, nous avons souligné que le GIEC reconnaît que les modèles climatiques, pris dans leur ensemble, surestiment largement le réchauffement de la troposphère, et il cite de nombreuses études, dont certaines auxquelles j’ai contribué, qui le démontrent. Pourtant, il n’attribue à ces déclarations qu’un niveau de confiance moyen. Or, il attribue un niveau de confiance très élevé à d’autres questions pour lesquelles les preuves sont pourtant très faibles. Il me semble que certaines de ces déclarations sont subjectives et relèvent de la rhétorique, visant à mettre l’accent sur un message plutôt que sur la solidité réelle des données quantitatives.
Je ne sais pas quelle serait l’alternative ; il est difficile de résumer des sujets vastes et complexes de manière pertinente. Mais je pense que, plus précisément, le GIEC a utilisé une méthodologie d’attribution très médiocre. Je crois que la méthodologie d’identification optimale est extrêmement défaillante, et j’ai publié des articles expliquant pourquoi. À mon avis, elle tend à négliger systématiquement le rôle de la variabilité naturelle et à surestimer celui des forçages anthropiques, et le GIEC a accordé un niveau confiance excessif à ses résultats-là.
De plus, le GIEC – et cela dure depuis 20 ans – a tendance à publier des séries de scénarios d’émissions incluant une fourchette haute qui n’a rien à faire là, qui ne correspond pas aux données historiques et qui, vu le scénario qu’il représente, n’a aucun sens. Leurs réponses sont très ambiguës lorsqu’on les interroge sur la crédibilité douteuse de ces scénarios d’émissions. Je pense que cela leur confère un avantage rhétorique : celui de pouvoir présenter une fourchette de projections de réchauffement et d’annoncer, par exemple, une hausse de six degrés. Lorsque ces projections apparaissent dans un journal ou dans un lieu public, le public ne voit pas la nuance, et qu’il s’agit en fait d’une projection extrême, et croit que le GIEC prévoit réellement un réchauffement aussi important.
C’est un cas où, à mon avis, la manière dont ils gèrent l’éventail des incertitudes entourant les scénarios d’émissions finit par induire le public en erreur plutôt que de le centrer sur les scénarios les plus réalistes et plausibles.
14. Comment évaluez-vous le rapport coût-efficacité des politiques climatiques actuelles, et existe-t-il des approches spécifiques qui, selon vous, permettraient de réduire les émissions plus efficacement ?
Eh bien, c’est un vaste sujet. Je dirais, que pour la plupart des politiques climatiques que nous connaissons, notamment celles des énergies renouvelables comme le solaire et l’éolien, le rapport coût-efficacité n’est en général pas atteint. C’est tout simplement tragique, à mon sens, de voir à quel point le monde a dépensé des sommes colossales pour ces systèmes énergétiques, alors que nous n’obtenons quasiment aucune électricité utile, ou alors une quantité infime, à un coût exorbitant.
Ensuite, il y a des questions comme l’obligation d’acquérir des véhicules électriques : ces problèmes se posent au Canada comme dans de nombreux autres pays du monde. Les gouvernements semblent trop enclins à céder aux intérêts des entreprises qui voient là une occasion de faire fortune en vendant au gouvernement une technologie qui nécessite son soutient par un encadrement réglementaire strict. Les véhicules électriques auront leur place sur le marché automobile, la technologie progresse et certains consommateurs les préféreront aux voitures à essence. Mais ces obligations tentent d’imposer cette transition bien trop tôt. C’est très rentable pour certains constructeurs automobiles et les industries qui les soutiennent, mais très coûteux pour les consommateurs et préjudiciable au secteur automobile traditionnel.
Cette approche n’est donc pas rentable et ne réduit que très peu les émissions. Les obligations relatives aux véhicules électriques ont un impact minime sur les émissions de gaz à effet de serre compte tenu de leur coût.
L’approche économique — et l’un des points que j’ai tenté de souligner dans le chapitre consacré à l’économie — vise principalement à envoyer au marché un signal de prix aussi clair que possible concernant le coût social des émissions de CO2, puis, de laisser le marché réagir à ce signal. Compte tenu du rôle prépondérant des combustibles fossiles dans le monde et de la nécessité de l’énergie, la réduction des émissions ne sera pas significative. Réduire la consommation de combustibles fossiles est très coûteux, et avec les technologies actuelles, nous ne prévoyons pas de réduction importante des émissions à court terme.
À terme, cela pourrait devenir moins cher. Il est peut-être possible de dissocier les émissions de CO2 de l’utilisation des combustibles fossiles. Ce n’est pas le cas actuellement, mais cela pourrait changer. Nous avons dissocié les particules fines, le soufre et le monoxyde de carbone de l’utilisation des combustibles fossiles, mais nous n’avons pas encore trouvé comment faire de même avec le dioxyde de carbone. Une fois cette solution trouvée, des options moins coûteuses apparaîtront, et c’est alors que l’on verra apparaître des approches beaucoup plus rentables pour gérer les émissions de CO2.
Le raisonnement économique a donc toujours été le suivant : pour le moment, nous allons devoir apprendre à vivre avec, espérer que cela ne devienne pas une crise et supposer qu’il y aura des améliorations technologiques, peut-être dans la seconde moitié du siècle, qui faciliteront la résolution du problème.
15. Que pensez-vous de l’obligation de neutralité carbone ?
Concernant l’objectif de neutralité carbone, je pense qu’il s’agit, au mieux, d’une tentative malavisée de la part des politiciens de se donner des airs héroïques, alors qu’ils n’ont aucune idée de la manière de mettre cela en œuvre. Au pire, je pense que, sur le plan géopolitique, il fragilise considérablement les industries et les capacités des pays occidentaux. Il offre à certains gouvernements hostiles, dont Pékin, l’opportunité de s’implanter dans des pays qui n’ont pas pu obtenir de financements pour leurs centrales électriques et le développement de leurs énergies fossiles, car l’objectif de neutralité carbone en Occident a tari les fonds destinés à ces projets. Cela a permis au gouvernement chinois de prendre le contrôle de nombreux pays en développement d’une manière qui, à mon sens, nuit à leurs intérêts.
16. Pensez-vous que les économistes sont systématiquement meilleurs ou moins bons que les physiciens pour raisonner sur une profonde incertitude — et quels angles morts votre propre discipline apporte-t-elle aux questions climatiques ?
Il faut dire que les économistes ont un avantage : en moyenne, ils sont bien plus formés aux méthodes quantitatives, à l’économétrie et aux statistiques que le physicien moyen. Si j’ai commencé à publier dans des revues de climatologie, c’est notamment parce que, dans de nombreux articles, les méthodes utilisées, pourtant issues de l’économie et de l’économétrie, étaient mal appliquées dans les revues de sciences physiques. Je pense que les économistes maîtrisent mieux le raisonnement et l’analyse statistiques.
En matière de raisonnement face à une incertitude profonde, chacun se heurte à la difficulté de formuler des prédictions sensées sur des événements qui pourraient se produire ou non dans un siècle. Les économistes sont habitués à étudier des phénomènes – notamment l’économie mondiale – qui ont connu des transformations radicales ; nous savons donc que la technologie d’aujourd’hui ne sera pas nécessairement la même que celle de demain. Nous savons également que les revenus et le niveau de vie peuvent évoluer considérablement en un siècle. Les physiciens, quant à eux, étudient des systèmes qui sont généralement très stables et peu sujets aux changements ; ils sont donc très attentifs à tout changement notable survenu au cours des cinquante dernières années.
Pour les économistes, notre angle mort serait sans doute que si l’on nous annonçait un réchauffement climatique de quelques degrés, avec les conséquences potentiellement désastreuses que cela pourrait engendrer, nous hausserions les épaules, du moins dans un premier temps, en nous contentant de dire : « D’accord, très bien, on peut vivre avec ça. » Le progrès des revenus et des technologies fait que nous ne percevrons probablement pas vraiment ce changement, compte tenu de toutes les autres choses qui vont évoluer au cours des cent prochaines années. Les physiciens, en revanche, seraient bien plus attentifs aux risques de surprises néfastes et de bouleversements sans précédent.
17. Comment faites-vous la distinction entre le scepticisme méthodologique et le scepticisme motivé dans votre propre prise de décision, en particulier lorsque les résultats correspondent à vos idées préconçues ?
Je ne maîtrise pas parfaitement ces termes, mais je crois comprendre que vous voulez dire : que le scepticisme méthodologique est ce qu’on attend normalement des scientifiques : ils cherchent à remettre en question les idées reçues et à évaluer la solidité des preuves. Le scepticisme motivé, quant à lui, relève davantage d’une attitude partisane : on cherche à défendre son camp et à discréditer l’autre. J’imagine que nous sommes tous susceptibles d’adopter ce dernier comportement.
Tous les acteurs du domaine, y compris en sciences physiques et les sciences exactes, s’accrochent à leur paradigme et à leur façon privilégiée d’appréhender les choses. Dans certains cas, on trouve des personnes qui ont bâti toute leur carrière sur une théorie particulière, et si des données semblent la contredire, ce seront ceux qui s’empresseront de les réfuter. À mon sens, il n’y a rien de mal à cela, pourvu que l’analyse de chacun soit transparente.
Finalement, je pense que l’essentiel est le suivant : lorsque vous publiez vos travaux, rendez-vous vos données et vos méthodes accessibles, et rédigez-vous votre document de manière à ce que les lecteurs comprennent précisément votre démarche ? Cela permet au lecteur d’évaluer votre travail. Un raisonnement motivé n’est pas forcément problématique en soi s’il vous conduit à la bonne réponse. Le problème survient lorsqu’il conduit à des pratiques trompeuses : par exemple, si vous tentez de dissimuler vos résultats en ne publiant pas vos données ou en falsifiant des informations.
C’est là qu’il faut rester vigilant. Personnellement, je m’efforce d’être très consciencieux quant à la publication de mes propres données. Je dirais que la situation s’est améliorée en climatologie, mais il existe encore de nombreux articles pour lesquels, lorsque je souhaite vérifier le travail de l’auteur, il est très difficile de trouver ses données, ou bien elles sont publiées de manière à être inutilisables, ou encore il faut demander un logiciel spécifique pour les rendre exploitables. Je pense que ce problème persiste dans de nombreux domaines scientifiques, y compris la climatologie.
18. Quels sont les facteurs institutionnels qui faussent le plus la recherche sur le climat aujourd’hui : les structures de financement, les biais de publication, le cadrage médiatique ou la demande politique de certitude ?
J’ai constaté qu’ici au Canada, les organismes de financement de la recherche ont délaissé les subventions ouvertes, axées sur la simple curiosité. Ils sont désormais beaucoup plus prescriptifs. Ils recherchent des sujets d’étude précis et l’annonce intègre généralement les conclusions directement dans le protocole de recherche.
Par exemple, il est désormais assez courant de voir des concours de subventions de recherche financés par l’État fédéral axés sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou la mesure des impacts néfastes du changement climatique sur la société. En annonçant une telle subvention, on présuppose le type de travaux que l’on est prêt à soutenir, au lieu de simplement laisser les scientifiques proposer le sujet et obtenir un financement en fonction de la qualité de la recherche proposée. Donc, se sont les organismes subventionnaires qui sont le problème.
Revues scientifiques : il est toujours possible de publier des articles, même s’ils vont à l’encontre des idées reçues. Cependant, au fil des années, et encore récemment, j’ai constaté que certains rédacteurs en chef – même lorsque vos résultats démontrent clairement, par exemple, que le dioxyde de carbone ne joue pas un rôle prépondérant dans les variations de température – se contentent de dire : « Ne le formulez pas ainsi ; essayez de minimiser l’importance de ce phénomène. » Ils refusent d’en discuter ; l’un d’eux a même déclaré : « Il s’agit de physique établie ; je ne veux pas rouvrir ce débat. » Alors même que les résultats étaient formels, le rédacteur en chef nous imposait des limites quant à la manière de les présenter.
Parallèlement, il existe suffisamment de revues et de comités de rédaction pour que, si vous persistez, vous trouviez des éditeurs qui accepteront de publier vos résultats, à condition qu’ils soient solides et validés par les pairs. Je réfute donc l’idée que la climatologie soit uniquement marquée par un contrôle d’accès à la publication. Certes, ce contrôle existe, mais je ne pense pas qu’il soit plus important que dans d’autres disciplines.

Le professeur Ross McKitrick ( Climate : The Movie )
19. Pensez-vous que les groupes de réflexion, quel que soit leur camp dans le débat climatique, ont rendu plus difficile pour le public de comprendre honnêtement l’incertitude ? Veuillez indiquer les organisations avec lesquelles vous avez collaboré dans votre réponse.
Il existe différents types de groupes de réflexion. Je pense notamment aux organisations de défense des intérêts, comme les groupes environnementaux, qui ne se considèrent pas vraiment comme des groupes de réflexion ; ce sont plutôt des groupes de lobbying et des associations militantes. Je pense qu’elles ont beaucoup contribué à brouiller les pistes avec un langage extrême.
Je voudrais également mentionner le Secrétaire général des Nations Unies. Je pense qu’il est la voix la plus irresponsable au monde sur cette question. Il tient des propos absolument insensés. Lors de la publication du sixième rapport d’évaluation du GIEC, il a crié à l’alarme « code rouge » et tous les dangers ce que le rapport signalait au gens, alors qu’il n’en était rien. Il a tout inventé. Je commencerais par lui : Guterres. Je le trouve extrêmement irresponsable.
Quand il fait des choses comme ça, et que les climatologues ne réagissent pas pour rectifier les faits, je suppose qu’ils se retrouvent dans une situation délicate, mais c’est là, à mon avis, qu’ils devraient être plus actifs pour contrôler cet aspect de la question.
Les groupes de réflexion auxquels j’ai participé se concentrent généralement sur les questions de politique économique. Il existe un fort recoupement entre les travaux économiques issus de ces groupes de réflexion et la littérature économique de référence. À ce propos, il peut paraître surprenant de constater que, de mon vivant – j’exerce ce métier depuis le début des années 1990 –, la communauté économique dominante n’a jamais vraiment soutenu de politiques climatiques ambitieuses. Je n’ai jamais constaté un grand intérêt économique pour la question de la neutralité carbone, tout simplement parce que le rapport coûts-avantages ne s’y prête pas. Par conséquent, les analyses économiques que j’ai menées au sein de ces groupes de réflexion suivent de très près les travaux publiés dans les revues économiques à comité de lecture.
Le monde des « think tanks », surtout aux États-Unis, est immense. Ils sont très nombreux, certains se concentrant sur les questions scientifiques, d’autres sur l’énergie et les réseaux électriques. Dans un pays où les « think tanks » sont peu nombreux, ils peuvent paraître comme de puissants groupes influents. Mais en réalité, leur nombre est tel, qu’aucun groupe de réflexion isolé à tendance à dominer le processus ; ils s’opposent plus ou moins les uns aux autres.
20. Existe-t-il une politique climatique à laquelle vous vous opposez non pas parce qu’elle est inefficace, mais parce qu’elle viole un principe que vous estimez que les économistes devraient défendre, même si les émissions diminuent ?
En réalité, cela s’applique bien au-delà de la seule politique climatique. L’approche économique des politiques publiques, que je soutiens, consiste à rechercher des options qui entravent le moins possible l’autonomie des individus. En particulier, si deux politiques aboutissent au même résultat – l’une par des mesures de marché volontaires, l’autre en imposant à l’État de dicter les choix de consommation et les activités quotidiennes de la population – nous privilégierions de loin la première. Même si elles aboutissent au même résultat, le simple fait de garantir l’autonomie des individus constitue une fin en soi.
Dans le cas du changement climatique, la question est particulièrement pertinente, car les économistes sont depuis longtemps convaincus qu’on peut y remédier par la tarification, grâce à un mécanisme de marché, idéalement une taxe carbone. Une fois celle-ci mise en place, on laisse les individus décider de la manière dont ils réagissent. Certains pourraient réduire considérablement leur consommation d’énergies fossiles, tandis que d’autres pourraient la maintenir et accepter de payer une taxe plus élevée. L’important est de leur laisser le choix.
Malheureusement, les décideurs politiques – même au Canada, où ils soutenaient en principe une taxe carbone – dès sa mise en place, ont décidé de ne pas renoncer à s’immiscer dans l’économie. Ils ont instauré plus de 100 autres mesures qui tentent de dicter nos choix quotidiens, jusqu’au type d’ampoule électrique, de machine à laver, de voiture, et aux normes d’isolation de notre maison – et la liste est loin d’être exhaustive.
Les économistes n’apprécient guère cette pratique car elle s’avère généralement très inefficace. Les coûts explosent sans que les résultats soient significatifs. Mais intuitivement, la plupart des gens finissent par comprendre que nous la rejetons car elle est intrusive et s’apparente à du contrôle social. Et si elle n’apporte aucun résultat concret, elle est d’autant plus contestable.
21. Selon vous, qu’est ce que les climatologues traditionnels comprennent le plus mal au sujet des critiques des économistes, et qu’est-ce que les économistes comprennent le plus mal concernant les contraintes des climatologues ?
D’après mon expérience, les climatologues ne semblent pas saisir les conséquences négatives d’une limitation de l’accès aux énergies fossiles. Ou peut-être pensent-ils qu’on pourrait facilement les remplacer ou maintenir notre niveau de vie sans elles, mais ce n’est pas le cas.
Quant aux lacunes des économistes en sciences physiques, la liste est longue. La plupart d’entre eux ignorent presque tout de la météorologie, de la climatologie, de la modélisation climatique et ce que sont les banques de données de base. S’il y a un point particulier que les climatologues souhaiteraient sans doute voir mieux compris par les économistes, c’est la possibilité de non-linéarités et de changements imprévus au sein du système climatique, dus à sa nature chaotique.
22. Y a-t-il des aspects de la science climatique dominante qui, selon vous, méritent aujourd’hui une réévaluation plus sérieuse ?
Oui, l’attribution, l’empreinte digitale optimale. Je pense qu’il y a beaucoup de résultats dans la littérature qui sont simplement erronés. Le GIEC a adopté une méthodologie que même nombre de ses membres ne comprenaient pas, et ils se sont contentés du fait qu’elle produisait des résultats positifs sans se soucier de leur validité statistique. Je pense qu’une sérieuse réévaluation s’impose. Nous l’avons déjà dit dans le rapport du Département de l’Énergie. Les réponses ? Presque personne n’a commenté là-dessus. La seule personne qui a répondu n’a pas cherché à la défendre ; elle a simplement dit : « Nous utilisons d’autres méthodes maintenant. » Mais j’ai examiné ces autres méthodes, et je pense qu’elles sont tout aussi mauvaises, voire pires à certains égards. Elles soulèvent des problèmes d’économétrie de séries temporelles plus complexes, que les revues scientifiques sur le climat ne sont pas vraiment en mesure de traiter actuellement.
Un autre problème concerne l’attribution des phénomènes météorologiques extrêmes. C’est devenu, d’une manière ou d’une autre, un sujet dominant d’actualité. Là encore, il s’agit d’une méthodologie qui a été adoptée immédiatement sans que ses lacunes soient sérieusement examinées, et le fait qu’elle continue de produire des résultats apparemment positifs, sans que les praticiens se demandent s’ils les apprécient, car cela leur confirme ce qu’ils veulent entendre. Je pense qu’ils devraient être beaucoup plus prudents.
Or, il y a certains spécialistes des événements extrêmes qui font preuve d’une grande prudence. L’une des critiques formulées à l’encontre du rapport du Département de l’Énergie (DOE) portait sur notre critique à l’égard de l’attention particulière accordée au Groupe mondial d’attribution des phénomènes météorologiques extrêmes : c’est une énorme machine de relations publique bénéficiant d’une forte couverture médiatique. Certains de nos détracteurs ont rétorqué : « Nous ne mettons pas tout le monde dans le même panier. Nous ne sommes pas tous comme ça. » Et ils ont raison : nombreux sont les analystes des phénomènes météorologiques extrêmes qui font preuve d’une grande prudence et ne tirent pas de conclusions hâtives.
Mais je pense que les acteurs dominants actuels dans le domaine de l’attribution des événements extrêmes vont commettre une erreur similaire — comme celle du graphique en forme de crosse de hockey, comme celle de l’empreinte digitale optimale — en s’emparant d’une méthodologie qu’ils ne comprennent pas vraiment parce qu’ils apprécient les résultats qu’elle leur donne.
23. D’après votre expérience, quelle part de la politique climatique américaine est guidée par des preuves scientifiques par rapport à des considérations politiques ou économiques ?
Très peu. Je pense que si l’on pouvait régler le problème à moindre coût, on suivrait tout simplement l’avis des scientifiques. Dans le cas des chlorofluorocarbones (CFC), lorsqu’il est apparu qu’ils détruisaient la couche d’ozone, une solution peu coûteuse existait déjà : des produits de substitution. Les anciens CFC ne présentaient aucun intérêt commercial réel ; il n’a donc pas coûté grand-chose de dire : « Très bien, adoptons une approche de précaution, interdisons ces CFC et imposons l’utilisation de l’alternative. » Certes, il y a eu des coûts, mais vraiment minimes, et personne ne s’en est aperçu. Ce serait un cas où les conclusions scientifiques, malgré leurs incertitudes, auraient servi de base à la décision.
Le problème avec le climat, c’est qu’il est intimement lié à l’utilisation des énergies fossiles. Qu’un pays soit producteur de pétrole ou non importe peu : tous les pays utilisent du pétrole, du gaz et du charbon, et dépendent des énergies fossiles pour leur niveau de vie. Il est inévitable que les décisions politiques suscitent de vives controverses et que la situation va être fortement politisée.
Il est également vrai que les données scientifiques sont beaucoup plus incertaines. Le débat ne se porte pas sur la question si le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre, mais sur l’ampleur de son impact sur le climat et sur les dégâts qu’il causerait réellement. Ce sont des questions bien plus complexes, et ces zones d’ombre seront sans doute comblées par beaucoup de considérations politiques.
24. Rétrospectivement, qu’est-ce que le Climategate a révélé sur les normes de la science du climat — comme le partage des données ou l’évaluation par les pairs — qui nécessitaient réellement une réforme ?
On accorde beaucoup trop d’importance au terme « évaluation par les pairs ». Je pense que le public a souvent cru que si un article paraissait dans une revue à comité de lecture, cela signifiait qu’une équipe entière d’évaluateurs l’avait examiné et vérifié qu’il ne contenait aucune erreur. Une partie de la surprise lors du Climategate a été la réalisation que, non, l’évaluation par les pairs ne fonctionne pas ainsi. Très rarement, les évaluateurs examinent les données ou tentent de reproduire l’analyse. Il s’agit souvent d’une évaluation assez superficielle.
Une autre surprise pour les gens, je crois, a été que le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) – dont on avait jusqu’alors parlé comme d’une instance regroupant des milliers de scientifiques parmi les plus éminents au monde, ont examiné minutieusement les données et sont parvenus à un consensus sur leur interprétation. Or, on a pu constater qu’il s’agissait en réalité de petits groupes de scientifiques travaillant sur différentes parties du rapport et décidant entre eux sur ce qu’ils voulaient dire. En cas de preuves contraires, ils disposaient d’une grande latitude pour ignorer les éléments qui leur déplaisaient. Je pense que cela a permis au public de se faire une idée plus réaliste du processus d’élaboration de rapports de cette envergure.
25. Avez-vous reçu un financement quelconque de l’industrie pétrolière pour soutenir vos recherches ?
Non. La plupart de mes recherches… ne sont financées du tout. J’utilise désormais uniquement des bases de données publiques et le logiciel R, qui est gratuit ; cela ne me coûte donc rien pour le faire. Je n’ai pas besoin d’embaucher de chercheurs associés ou d’assistants.
Les financements que j’ai reçus au fil des ans provenaient du gouvernement fédéral et du Conseil de recherches en sciences sociales et humaines. J’ai même obtenu une fois une subvention d’un organisme financé par George Soros, chose assez surprenante. Il s’agissait du « Institute for New Economic Thought », qui avait apprécié une proposition de projet que j’avais soumise et m’a donc accordé un financement – mais ce fut une expérience unique.
Non, je n’ai pas bénéficié de financements externes pour la recherche depuis longtemps, car, comme je l’ai dit, je ne dirige pas de laboratoire, je n’ai pas d’employés et je n’ai besoin d’aucun financement.
26. En faisant abstraction de la politique, que révèle l’épisode de la crosse de hockey sur les forces et les limites de la reconstitution paléoclimatique ?
Steve et moi avons tenté de démontrer que la méthodologie était erronée. Elle était tout simplement fausse, et pourtant, de nombreux scientifiques l’ont utilisée. Ils ont réutilisé l’algorithme défectueux d’analyse en composantes principales de Mann, et je pense que, séduits par les résultats, ils ont obtenu une courbe en forme de crosse de hockey très esthétique. Le GIEC a retenu ce résultat, malgré l’existence, à la même époque, d’autres reconstructions qui ne montraient pas la même chose, mais ils les ont ignorées. Ils ont privilégié la courbe en forme de crosse de hockey et l’ont largement promue.
Tout cet épisode, je crois, a révélé – vous avez d’ailleurs utilisé l’expression « raisonnement biasé » tout à l’heure – qu’au sein même de la direction du GIEC, ce type de raisonnement est à l’œuvre. Ils ont un discours qu’ils souhaitent promouvoir et sont très attentifs aux études qui confortent leur version des faits. Parfois, le raisonnement biaisé mène à la bonne conclusion, mais dans ce cas précis, ils ont ignoré les preuves contraires et se sont appuyés sur une étude biaisée dont les données ne corroboraient pas la conclusion, ce qui les a induits en erreur.
27. Vos recherches ont souvent remis en question les estimations les plus élevées de la sensibilité climatique. D’après les données actuelles, quelle est selon vous la fourchette la plus fiable pour la sensibilité climatique, et pourquoi ?
Concernant la sensibilité, je préfère laisser la parole à quelqu’un comme Nic Lewis, bien plus compétent en analyse statistique. Dans nos travaux avec John Christy, nous avons plutôt abordé la question sous l’angle des modèles capables de reproduire les changements climatiques observés. La réponse réside dans les modèles présentant la plus faible sensibilité. Même dans ce cas, si l’on considère la troposphère moyenne, le réchauffement reste trop important et l’amplification avec l’altitude est excessive.
D’après cette analyse, je dirais que les modèles présentant la plus faible sensibilité climatique — actuellement de l’ordre de 1,8 à 2,5 °C — semblent être les plus pertinents. C’est sur eux qu’il faut se concentrer pour comprendre la sensibilité globale du système climatique.
Dans le rapport du Département de l’Énergie (DOE), nous avons examiné divers arguments expliquant pourquoi le système climatique pourrait être plus sensible que ne le montrent les modèles, car de futurs effets de configuration pourraient amplifier cette sensibilité. Je pense qu’il s’agit d’une piste de recherche importante, mais nous avons également souligné que le principal effet de configuration évoqué est un gradient de température dans le Pacifique tropical. Or, dans ce cas, les données historiques vont à l’encontre des prévisions des modèles : le gradient ne se renforce pas comme les modèles le prévoient. En analysant les réponses, les critiques ont reconnu que c’est ce que montrent les données, mais ont fait valoir que cela pourrait changer à l’avenir. Je suis ouvert à cette possibilité, mais pour l’instant, cet argument est assez faible.
Cet entretien a été initialement publié sur « Dungeons of Science », le site web du journaliste scientifique Manish Koirala.
Traduction : Eric Vieira
more news
More on the New Climate Report from the US DOE
This report will be a very useful mechanism to allow much more open dialogue on the climate change policy journey that will affect us all. It’s clear from this report that Climate science is far from settled and that the past frozen narrative of the climate emergency is over.
The Ethics of Uncertainty: Science as a Public Dialogue
The title of this post is borrowed from Marcoen Cabbolet’s recent paper. Its abstract is the following, but I warmly recommend reading the entire paper.
Chris Martz 2000th signatory of the World Climate Declaration
An Interview with Chris Martz.