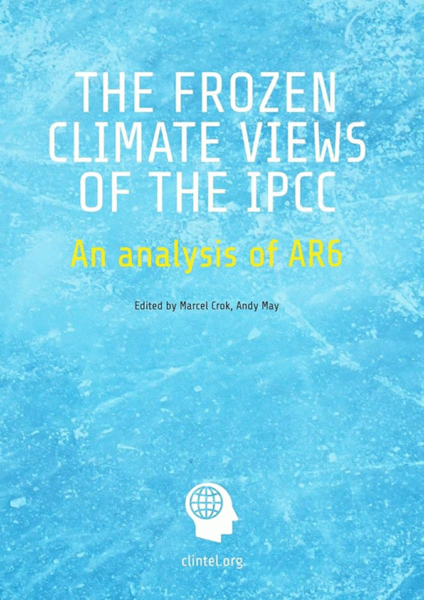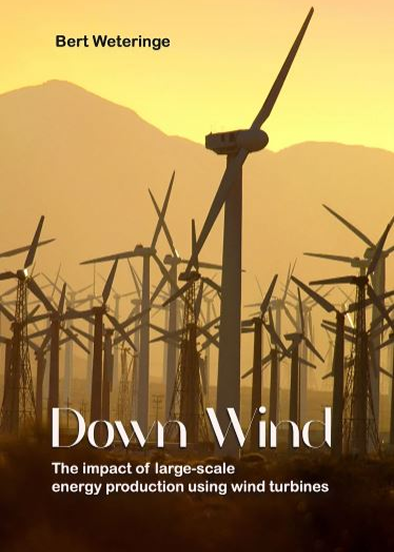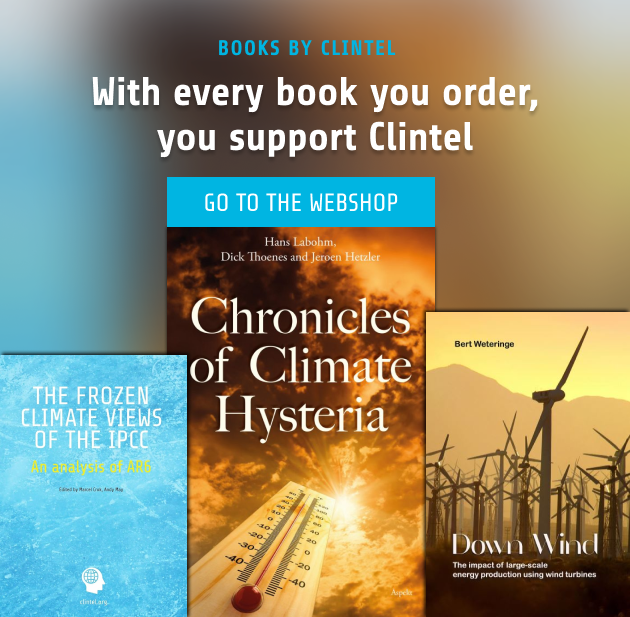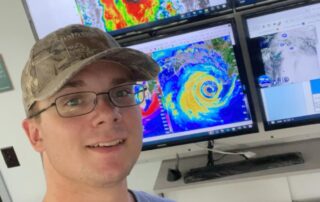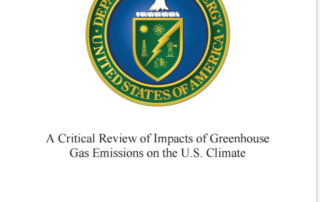La classe des consultants reconnaît tardivement les réalités énergétiques
Dans son dernier commentaire, Vijay Jayaraj, consultant devenu analyste, révèle comment l’élite des conseillers commence seulement maintenant à tenir compte les contraintes concrètes des systèmes énergétiques mondiaux. Selon Jayaraj, ce retard témoigne d’un décalage systémique entre la théorie économique et la réalité énergétique.
Un nouveau rapport de McKinsey & Company, intitulé « Perspectives énergétiques mondiales », met en lumière ce que beaucoup d’entre nous – qualifiés de « climatosceptiques » – affirmons depuis toujours : le charbon, le pétrole et le gaz naturel resteront les principales sources d’énergie mondiale bien au-delà de 2050.
Les prévisions de McKinsey pour 2025 revoient fortement leurs projections précédentes. L’an dernier, les modèles des consultants du conseil de gestion tablaient sur une baisse de 40 % de la demande de charbon d’ici 2035. Aujourd’hui, McKinsey anticipe une hausse de 1 % sur la même période. Ce revirement spectaculaire s’explique par la mise en service record de centrales à charbon en Chine, l’augmentation inattendue de la consommation mondiale d’électricité et l’absence d’alternatives viables pour des secteurs comme la sidérurgie, la chimie et l’industrie lourde.
Le rapport indique que les trois combustibles fossiles fourniront encore jusqu’à 55 % de l’énergie mondiale en 2050, une prévision qui me paraît sous-estimée. Aujourd’hui, les hydrocarbures représentent plus de 60 % de la production d’électricité et plus de 80 % de la consommation d’énergie primaire.
Quoi qu’il en soit, le rapport de McKinsey confirme ce que les analystes énergétiques chevronnés et les décideurs politiques pragmatiques affirment depuis longtemps : la transition énergétique ne sera ni rapide, ni simple, ni uniquement régie par des objectifs climatiques. En réalité, cette transition énergétique ne pourra avoir lieu sans un déploiement à grande échelle du nucléaire, de la géothermie ou d’autres innovations technologiques qui auront démontré leur viabilité.
Dans des régions comme l’Inde, l’Asie du Sud-Est et l’Afrique subsaharienne, les priorités énergétiques absolues sont l’accès, l’abordabilité et la fiabilité, qui contribuent ensemble à la sécurité nationale. Les planificateurs sont parfaitement conscients du risque : une dépendance exclusive sur une énergie soumise aux aléas météorologiques expose le pays à des coupures de courant, des perturbations industrielles, un déclin économique et des troubles civils.
C’est pourquoi de nombreux pays en développement adoptent une stratégie parallèle: de poursuivre leurs investissements dans la production d’électricité conventionnelle (charbon, gaz, nucléaire) tout en développant des technologies alternatives. McKinsey l’exprime ainsi dans son jargon de consultant : « Les pays et les régions suivront des trajectoires distinctes en fonction de leur situation économique locale, de leurs ressources et des réalités propres à chaque secteur industriel. »
Dans des pays comme l’Inde, l’Indonésie et le Nigéria, l’électrification et l’expansion industrielle prennent une ampleur considérable. Ces pays ne peuvent pas se permettre d’attendre des décennies pour des solutions parfaites ; ils ont besoin de solutions « fiables et satisfaisantes actuellement». Cela signifie que les combustibles fossiles seront maintenus.
L’analyse de McKinsey souligne également ce que dictent la physique et l’ingénierie : les sources intermittentes et dépendantes des conditions météorologiques, telles que l’éolien et le solaire, nécessitent de vastes superficies, des batteries de secours et des investissements dans la production et le réseau électrique, autant d’éléments qui ne sont ni bon marché ni rapides à mettre en œuvre.
Les technologies éoliennes et solaires, qualifiées d’énergies renouvelables, devraient plutôt être qualifiées de fléaux économiques. Elles engendrent des systèmes électriques coûteux et instables qui ont mis à genoux des pays riches en énergie comme l’Allemagne. Après avoir dépensé des milliards de dollars dans des éoliennes et des panneaux solaires peu fiables, et démantelé leurs centrales nucléaires et à charbon, le pays est confronté à une flambée des prix et à une stagnation économique.
Les Allemands ont désormais un mot pour désigner la crise qu’ils se sont eux-mêmes infligée : Dunkelflaute. Ce terme signifie « période de calme sombre », désignant une période de froid, d’obscurité et d’absence de vent durant laquelle leur réseau électrique « vert » est défaillant. Lors d’une Dunkelflaute en novembre 2024, les énergies fossiles ont été sollicitées pour fournir 70 % de l’électricité allemande.
Si les énergies renouvelables étaient réellement performantes, les planificateurs fermeraient les centrales à combustibles fossiles. Or, ce n’est pas le cas. Même si l’éolien et le solaire sont développés dans certaines régions, le charbon et le gaz naturel restent des combustibles très prisés. Rien qu’au premier semestre 2025, la Chine a mis en service environ 21 gigawatts (GW) de nouvelles centrales à charbon, soit plus que tout autre pays et la plus forte augmentation depuis 2016.
Par ailleurs, la Chine a approuvé la construction de 25 GW de nouvelles centrales à charbon au cours du premier semestre 2026. En juillet, la Chine continentale comptait près de 1 200 centrales à charbon, dépassant largement le reste du monde.
McKinsey souligne une forte augmentation de la demande d’électricité, alimentée par les centres de données, estimée à environ 17 % par an entre 2022 et 2030 dans les 38 pays de l’OCDE. L’énergie éolienne et solaire ne peuvent pas à elles seules répondre à une telle croissance de la consommation d’électricité.
Lorsque des analystes, des journalistes et des ingénieurs mettent en lumière ces réalités, ils sont traités de « vendeurs » de l’industrie des énergies fossiles. Pourtant, exposer les principes physiques et économiques qui sous-tendent les calculs nécessaires pour satisfaire les besoins énergétiques mondiaux n’a rien à voir avec les relations publiques. Ignorer ces faits, c’est nier que l’accès à une énergie fiable demeure le fondement de la civilisation moderne.
Le coût des politiques « vertes » insensées se traduit par des pertes d’emplois, des entreprises ruinées, des vies bouleversées et l’appauvrissement qui auraient pu être évités par des choix plus judicieux.
Pour ceux qui répètent les réalités énergétiques depuis des années, cette reconnaissance est douce-amère. La satisfaction d’avoir eu raison est tempérée par la conscience que beaucoup ont souffert parce que la réalité a été ignorée.
Traduit par Eric Vieira

Vijay Jayaraj
Vijay Jayaraj est chercheur associé à la CO₂ Coalition, à Fairfax, en Virginie. Il est titulaire d’une maîtrise en sciences de l’environnement de l’Université d’East Anglia, d’un diplôme d’études supérieures en gestion de l’énergie de l’Université Robert Gordon, toutes deux au Royaume-Uni, et d’une licence en ingénierie de l’Université Anna, en Inde Inde. Ce commentaire a été publié pour la première fois dans le Daily Caller du 9 novembre.
more news
The Ethics of Uncertainty: Science as a Public Dialogue
The title of this post is borrowed from Marcoen Cabbolet’s recent paper. Its abstract is the following, but I warmly recommend reading the entire paper.
Chris Martz 2000th signatory of the World Climate Declaration
An Interview with Chris Martz.
New Climate Assessment Report from US DOE
Climate science is baaaack. Energy Secretary Chris Wright has commissioned a new climate assessment report.