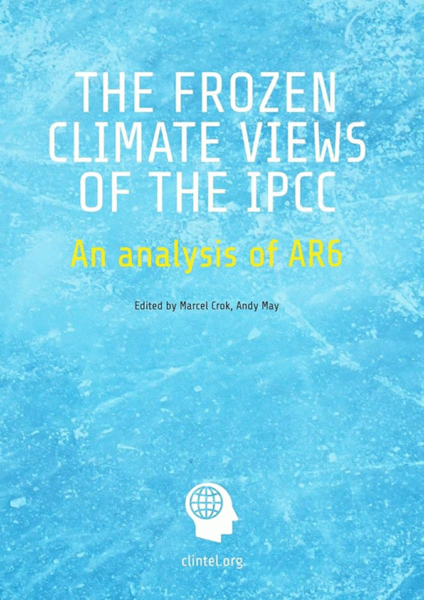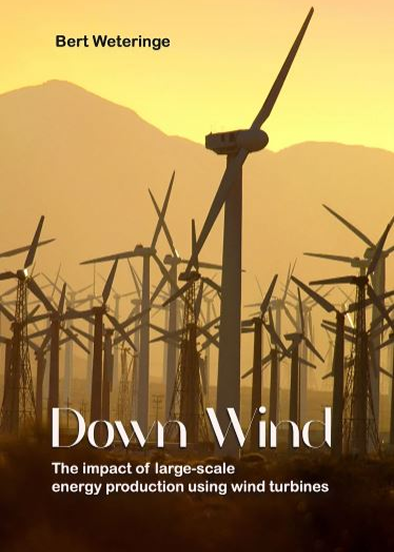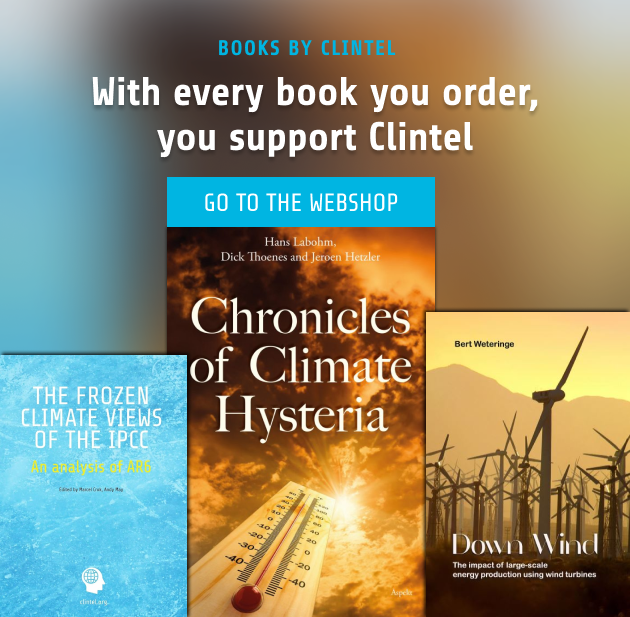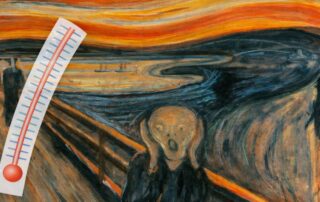Trump écrase le dogme climatique alors que l’Europe double la mise
En seulement trois mois, Donald Trump a redéfini la trajectoire de la politique énergétique, tant au niveau national qu’international. Ce changement n’affecte pas le climat atmosphérique, mais plutôt le climat idéologique. Par Samuel Furfari, publié pour la première fois au European Conservative
En seulement trois mois, il a redéfini la trajectoire de la politique énergétique, tant au niveau national qu’international. Ce changement n’affecte pas le climat atmosphérique, mais plutôt le climat idéologique qui a été façonné par trois décennies de politiques climatiques restrictives et souvent irréalistes. Sous la bannière de la « fierté énergétique », Trump a bouleversé l’ordre établi en adoptant des politiques favorables aux combustibles fossiles tout en démantelant les politiques « vertes » de son prédécesseur, Joe Biden. Ce changement marque un tournant dans la gestion des ressources énergétiques américaines et dans la géopolitique de l’énergie mondiale. Examinons les éléments clés de cette stratégie et ses implications pour de nombreux pays et, plus généralement, pour l’UE.
Un climat politique transformé : La Rupture avec le climatisme
Le premier acte symbolique de Trump pour affirmer sa nouvelle politique énergétique a été de retirer les États-Unis de l’Accord de Paris sur la décarbonisation. Ce retrait, lancé lors de son premier mandat, a été confirmé lors de son retour à la Maison Blanche. Trump considère l’accord comme une atteinte à la souveraineté économique des Etats-Unis, une sorte de « nouvelle arnaque verte » visant à pénaliser les pays industrialisés au profit d’acteurs comme la Chine et l’Inde. Cette décision envoie un message clair : les États-Unis ne se soumettront plus aux politiques climatiques internationales qu’ils considèrent comme néfastes pour leur compétitivité économique et énergétique.
En effet, Donald Trump a non seulement retiré les États-Unis de l’Accord de Paris, mais a également entrepris une refonte complète de la politique énergétique, en recentrant les priorités sur les énergies fossiles, en relançant le secteur délaissé du « charbon propre » et en s’opposant aux initiatives internationales et celles des états, comme celles de la Californie, qui étouffent le développement énergétique américain. Cette position controversée vise à restaurer la compétitivité et la sécurité énergétique des États-Unis.
Il ne s’agit pas seulement d’une position défensive. Trump a également lancé une attaque frontale contre les politiques anti-combustibles fossiles, les qualifiant de « nuisibles et dangereuses ». Selon lui, cette vision ignore les besoins énergétiques réels de l’économie mondiale.
La mise en œuvre de la domination énergétique
L’un des piliers de cette stratégie est la réduction massive des subventions et des financements publics pour les projets d’énergies renouvelables. La proposition de l’administration Trump, dirigée initialement par Elon Musk, a été de couper près de 10 milliards de dollars de financement pour le développement de technologies telles que l’utopie de l’hydrogène vert, la capture et l’utilisation du carbone (CCUS) et le stockage de l’énergie. Ces coupes remettent en cause des partenariats emblématiques avec des géants comme ExxonMobil et Occidental Petroleum qui, dans le cadre de leur stratégie d’image de marque verte, étaient prêts à investir une petite partie de leurs budgets publicitaires dans ces dépenses fantaisistes.
L’UE, quant à elle, continue de promouvoir des technologies telles que l’hydrogène « vert », malgré le coût exorbitant de sa production par électrolyse. Cela est d’autant plus vrai que de grands fonds d’investissement comme BlackRock ont décidé de ne plus financer cette folie chimique. Comme je l’ai montré dans « L’illusion de l’hydrogène » ( ‘The Hydrogen Illusion’), cette voie est une aberration énergétique et économique. On ne peut pas brûler de l’hydrogène, un élément clé de l’industrie chimique, juste pour satisfaire une lubie climatique. C’est comme brûler un sac Louis Vuitton pour se réchauffer : absurde et contre-productif.
L’administration Trump prévoit également de supprimer 8 500 emplois au sein du ministère de l’Énergie (DOE).
Par décret exécutif, le président a chargé le procureur général d’identifier toutes les lois, d’autres réglementations, ainsi que des pratiques des états et locales, qui entravent l’identification, le développement, la localisation, la production ou l’utilisation des ressources énergétiques nationales et qui sont ou pourraient être inconstitutionnelles, préemptées par la loi fédérale ou autrement inapplicables. M. Trump demande la suppression de toutes les dispositions qui, selon lui, concernent le « changement climatique » ou qui auraient à voir avec des initiatives « environnementales, sociales et de gouvernance », la « justice environnementale », les « émissions de carbone ou de gaz à effet de serre » et les fonds destinés à la collecte de pénalités ou de taxes sur le carbone. Il a lancé une guerre diplomatique contre des états comme la Californie qui imposent des « limites irréalisables ».
M. Trump a également pris des mesures audacieuses pour garantir l’approvisionnement en matériaux essentiels aux technologies modernes. En avril 2025, il a signé un décret autorisant l’exploitation minière dans les eaux de la zone économique exclusive des États-Unis. L’objectif est de collecter un milliard de tonnes de matériaux critiques en dix ans, notamment des nodules polymétalliques riches en cobalt, en nickel, en cuivre et en terres rares. L’administration estime que cette initiative pourrait ajouter 300 milliards de dollars au PIB américain en dix ans et créer 100 000 emplois. Les ONG environnementales s’opposent à cette décision, invoquant les risques marins. Mais pour Trump, elles représentent les ennemis économiques de l’Amérique sur la question stratégique de dépasser la Chine au niveau les ressources critiques.¨
Le cœur de la stratégie de Trump reste le soutien politique massif aux combustibles fossiles. Il s’agit notamment de
- Réduire les délais d’obtention des permis pour les projets pétroliers et gaziers ; le secrétaire d’État à l’intérieur, Doug Burgum, a promis de délivrer les permis en 14 jours seulement.
- Relancer l’industrie du charbon propre grâce à des subventions pour moderniser les infrastructures existantes, bien qu’il reste à voir si cela sera possible étant donné que le gaz de schiste est moins cher que le charbon pour la production d’électricité.
- • Augmenter les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL), en particulier vers l’UE, afin de réduire la dépendance de l’Europe à l’égard du gaz russe.
En devenant un exportateur dominant de pétrole et de gaz, les États-Unis renforcent leur influence géopolitique. L’exportation de GNL vers l’Europe, par exemple, réduit l’influence de la Russie et renforce les alliances transatlantiques.
Opposition aux réglementations étrangères
L’administration Trump a également lancé une offensive contre les réglementations européennes. Elle les considère comme une menace pour les entreprises américaines. Un exemple est la loi Protect USA Act, qui interdit aux entreprises américaines stratégiques de se conformer aux exigences ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) imposées par l’Union européenne. Cette loi protège les secteurs clés de l’industrie des combustibles fossiles et de l’extraction, tout en affirmant la souveraineté économique des États-Unis.
L’accent mis sur l’extraction de minerais essentiels reflète une volonté explicite de concurrencer la Chine, qui contrôle actuellement une grande partie de la chaîne d’approvisionnement mondiale en terres rares. La sécurisation de leurs propres ressources est essentielle pour garantir l’indépendance technologique des États-Unis.
Dans ce contexte, l’annonce de Donald Trump au 100e jour de son mandat, d’un accord entre les États-Unis et l’Ukraine sur les ressources naturelles couronne cette période de décisions stratégiques, mettant également en évidence les failles de la politique européenne. Cet accord ne concerne pas les terres rares, comme cela a été affirmé de manière erronée à plusieurs reprises – celles-ci ne se trouvent pas en quantités significatives en Ukraine – mais un large éventail de ressources naturelles, dont le gaz naturel, le manganèse, le titane et le graphite. Il garantit à l’Ukraine des investissements cruciaux pour son développement, tout en permettant aux États-Unis de s’assurer des approvisionnements en dehors de la sphère d’influence de la Chine.
Les événements récents montrent à quel point Donald Trump a changé le climat énergétique
En seulement 100 jours, Donald Trump a bouleversé le climat politique et géopolitique en matière d’énergie, en inversant les politiques climatiques de ses prédécesseurs et en esquissant une stratégie claire de domination énergétique. Cette stratégie repose sur une logique pragmatique : assurer la souveraineté énergétique des États-Unis, renforcer sa compétitivité économique et utiliser l’énergie comme levier géopolitique. Si l’UE persiste dans sa politique climatique idéologique, elle risque d’être de plus en plus marginalisée.
La grande multinationale BP l’a bien compris. Elle vient d’abandonner sa politique verte, à l’origine de ses contre-performances, et a également décidé de se séparer de sa directrice cheffe de stratégie, Giulia Chierchia, qui était à l’origine de la stratégie de transition verte de l’entreprise. Son poste de responsable du développement durable sera également supprimé. Quand est-ce que la Commission européenne va supprimer nombre de ces emplois verts, comme le fait Donald Trump ?
Nous nous attendions à une panne, et cela s’est passé …
L’administration Trump a dû rire en assistant à l’humiliation de l’Espagne antinucléaire, qui a investi massivement dans le solaire et l’éolien. Ces sources d’énergie ont fragilisé le réseau électrique national et au-delà, puisque le Portugal et la France ont également été touchés. La stabilité d’un réseau est assurée par l’inertie de grandes masses tournantes comme les turbines et les alternateurs des centrales thermiques et nucléaires. Les énergies renouvelables intermittentes et variables ne peuvent garantir cette inertie, essentielle aux systèmes électriques.
Avec une faible pénétration dans le mix énergétique, les énergies renouvelables ne posent pas de problèmes majeurs pour le réseau, car elles bénéficient de l’inertie des équipements conventionnels, qui représentent la majorité de la production. En revanche, lorsque leur part dépasse 30 à 40 %, les risques d’instabilité deviennent très importants. Lors de la panne du 28 avril 2025, elles représentaient 75 % ! Ces choix ont fait grimper les prix de l’électricité, car le solaire excédentaire a dû être écoulé à des prix négatifs. Ce modèle, présenté comme un exemple à suivre (les autorités se sont vantées le 22 avril de produire 100% d’électricité renouvelable), s’est révélé être un échec technique et économique retentissant. Il restera un exemple que tous les étudiants en ingénierie devront étudier. Il ne fait aucun doute que l’administration Trump utilisera cet échec de l’UE pour saper davantage les énergies renouvelables intermittentes et variables.
Comme l’ont dit les pères fondateurs de la Communauté européenne lors de la conférence de Messine en juin 1955, « il n’y aura pas d’avenir sans une énergie abondante et bon marché ». Trump l’a compris et a changé le climat de la politique énergétique. Bruxelles-Strasbourg l’a oublié.
Samuel Furfari, Docteur ès Sciences, est professeur de géopolitique de l’énergie dans plusieurs universités. Il enseigne actuellement à l’ESCP de Londres et est professeur honoraire à l’École polytechnique de l’université de Madrid. Il a enseigné la politique énergétique et la géopolitique à l’Université libre de Bruxelles de 2003 à 2021. Il a été haut fonctionnaire européen à la DG Énergie de la Commission européenne pendant 36 ans. De 2019 à 2022, il a été président de la Société européenne des ingénieurs et des industriels. Il est l’auteur de 18 livres et de nombreux articles.
Traduit par Eric Vieira
more news
Challenges to the CO2 Global Warming Hypothesis: (13) Global Warming Entirely from Declining Planetary Albedo
Is the recent warming the result of less reflection of sunlight by the Earth? Two researcher state that declining albedo — not CO₂ — dominates the temperature trend.
Guardian Claims We’re Still Only Approaching the Climate Point of No Return
The Guardian claims the world is edging toward a climate “point of no return,” where unstoppable warming will lock Earth into a catastrophic “hothouse” future. Yet the geological record tells a very different story. Past periods of far higher temperatures and CO₂ levels did not end life or civilization’s prospects — they supported abundance and evolutionary expansion.
The EV experiment has become a bloodbath — $140 billion wasted — more to come
The electric vehicle push was supposed to reshape the auto industry and accelerate the energy transition. Instead, mounting losses and collapsing share prices are raising serious questions about whether governments and manufacturers misread the market. What began as a bold industrial gamble is now looking, to some critics, like one of the most expensive policy experiments in recent automotive history.