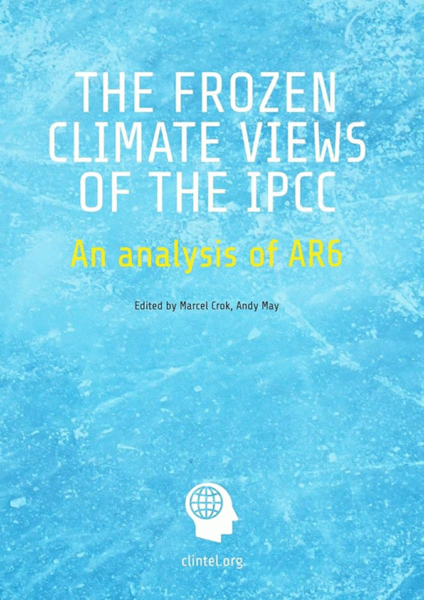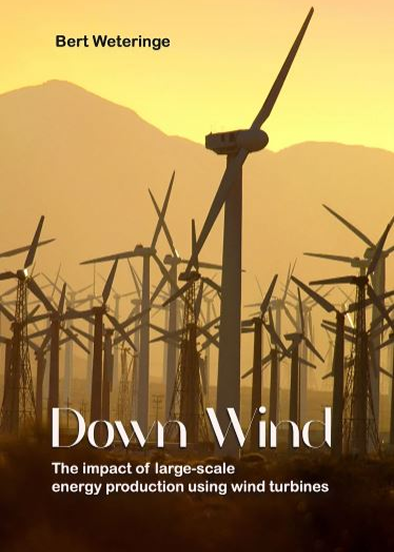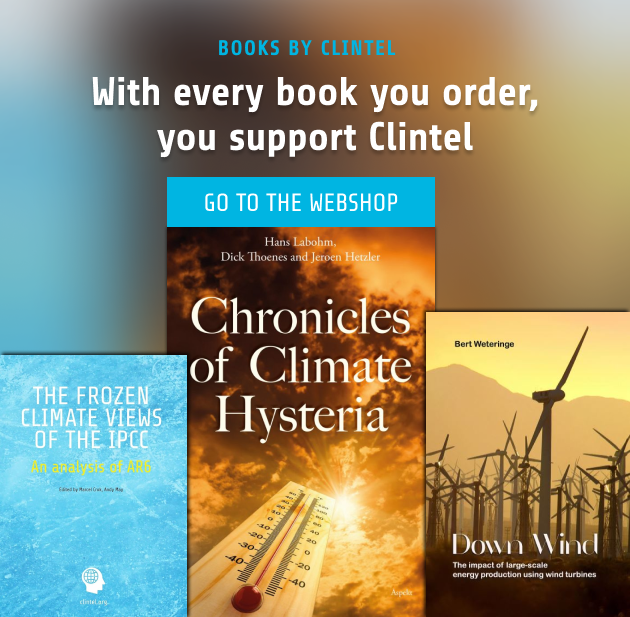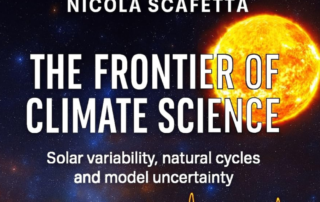Les accords de Paris en tant qu’« assurance climatique »–inabordable et inutile
Le débat sur le changement climatique continue de faire rage. Bien que la science ne soit toujours pas réglée, ce qui semble être réglé, c’est que le président Trump va se retirer, une fois de plus, des désormais tristement célèbres « Accords de Paris sur le climat. » Il est important de noter que ces accords sont centrés sur les engagements pris pour modifier les politiques énergétiques nationales.Ce qui suit est basé sur les remarques faites par Koonin et Mills lors d’un débat de l’Alliance pour la liberté d’expression du MIT, que l’on peut consulter ici.

Ce qui suit est basé sur les remarques faites par Koonin et Mills lors d’un débat de l’Alliance pour la liberté d’expression du MIT, que l’on peut consulter ici.
Clintel Foundation
Date: 20 December 2024
La décision de se retirer des accords de Paris n’est pas un simple geste. Le fait essentiel pour les citoyens du monde entier est que les prétendues « solutions climatiques » déploieraient des milliers de milliards de dollars et mettraient en œuvre des mandats et des diktats pour l’approvisionnement et l’utilisation de l’énergie dans tous les aspects de la société.
La raison invoquée pour justifier les propositions visant à modifier complètement la façon dont la civilisation est alimentée est la nécessité d’une « police d’assurance » contre les futures catastrophes climatiques. Dans ce cadre, les personnes qui craignent pour le climat affirment qu’une certaine possibilité de dommages futurs justifie la décision « responsable » d’« acheter » une assurance maintenant. Mais ce concept d’« assurance », souvent débattu, suppose que nous en savons suffisamment pour assurer que les conséquences du changement climatique futur justifient le paiement d’une assurance – et, accessoirement, que nous savons que l’« assurance » elle-même sera abordable.
Il s’avère que nous en savons beaucoup sur ces deux domaines. Comme nous le soulignons ci-dessous, la réalité nous montre que les conséquences du changement climatique que nous essayons d’éviter seront modestes – et que les coûts de l’« assurance » sont faramineux.
Contre quoi nous assurons-nous ?
La proposition de payer pour une « assurance climatique » exige que nous considérions d’abord les « avantages » d’une décarbonisation sur 50 ans, une échelle de temps qui découle de l’objectif de Paris de limiter l’augmentation de la température moyenne mondiale à 2°C. Nous pouvons ensuite évaluer ces avantages par rapport aux coûts de réalisation de l’objectif dit «Zéro émission nette » des émissions de gaz à effet de serre. Cette comparaison est compliquée, notamment en raison des incertitudes concernant les impacts prétendument évités par la réduction de l’influence humaine sur le climat. Il y a également la question des « coûts et avantages pour qui », ainsi que la question de savoir si c’est réellement urgent de réduire les émissions.
Il y a trois points à souligner : le calendrier de réduction des émissions est arbitraire ; la « menace » climatique est loin d’être désastreuse ; et le calcul des coûts et des bénéfices dépend beaucoup de la personne qui fait le calcul.
Commençons par l’objectif de Paris lui-même, qui vise à maintenir l’augmentation de la température moyenne à la surface du globe à moins de 2°C, ce qui, selon les modélisateurs climatiques, nécessiterait des émissions mondiales nettes nulles au cours de la seconde moitié de ce siècle. Entre-temps, les émissions continuent d’augmenter et atteindront à nouveau un niveau record cette année. Les sous-titres du rapport annuel des Nations unies sur les écarts entre les besoins et les perspectives en matière de réduction des émissions donnent une idée de l’absence de progrès : en 2023, il s’agissait d’un « record battu », « les températures atteignent de nouveaux sommets, mais le monde ne parvient pas à réduire les émissions (une fois de plus) », et cette année, c’était « Arrêter l’air chaud, s’il vous plaît ». Mais même ces 2°C ne constituent pas une limite absolue. Lorsqu’on a demandé à Hans Schellnhuber, le soi-disant « père de la limite des deux degrés », pourquoi il avait donné ce chiffre, il a répondu que c’était à peu près juste et que c’était un chiffre facile à retenir pour les politiciens. Il n’y a aucune raison crédible d’affirmer que le chaos le plus total se produirait soudainement si la température augmentait de deux, voire de trois degrés.
La question suivante est de savoir si la menace climatique est si grave qu’elle nécessite des actions précipitées et prométhéennes – c’est-à-dire la transformation de l’ensemble du système énergétique mondial en l’espace de quelques décennies. La réponse à cette question n’est pas aussi incertaine que le prétendent les prophètes du malheur. L’histoire récente nous donne quelques indications, puisque la planète s’est réchauffée de 1,3 °C au cours des 120 dernières années et que l’on s’attend à un réchauffement du même ordre au cours du siècle à venir. Au lieu d’une catastrophe, l’humanité a connu une prospérité sans précédent au cours de cette période : l’espérance de vie moyenne est passée de 32 à 72 ans, le PIB par habitant a été multiplié par sept, le taux d’alphabétisation a grimpé en flèche et le taux de mortalité dû aux phénomènes météorologiques extrêmes a été divisé par 50 ! Il est donc difficile de croire qu’un réchauffement comparable au cours du prochain siècle puisse compromettre ces progrès de manière significative. En fait, le consensus des études d’impact économique, tel que publié l’année dernière, par la Maison-Blanche de Biden, c’est qu’il y aurait une diminution de quelques pour cent du PIB pour quelques degrés de réchauffement. C’est « dans le bruit de fond », comme disent les physiciens. Bien sûr, il y aura des impacts différenciés, il y a des incertitudes et le PIB n’est pas la seule mesure du bien-être. Néanmoins, les prédictions de catastrophe ne sont pas crédibles.
Si vous écoutez les médias populaires, vous pourriez croire que nous, les humains, avons déjà déréglé le climat. Pourtant, même le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) ne parvient pas à dégager de tendances significatives pour la plupart des facteurs d’impact sur le climat, et encore moins de les attribuer à l’influence humaine. Les pertes dues aux phénomènes météorologiques extrêmes sont en train de diminuer en pourcentage du PIB, à mesure que le monde devient plus résilient. Les projections relatives à l’ampleur du réchauffement futur ont diminué à mesure que le GIEC affine ses modèles et que le monde émet un peu moins de CO2 que prévu, en raison du ralentissement de la croissance économique et de l’adoption de sources d’énergie à faible teneur en carbone.
Enfin, il y a la question de savoir « pour qui ça vaut la peine ». Alors que les 1,5 milliard d’habitants des pays développés disposent d’une énergie suffisante, la plupart des habitants de la planète ont besoin de beaucoup plus. Les inégalités sont stupéfiantes. La consommation d’énergie par habitant au Nigeria est 30 fois inférieure à celle des États-Unis, et quelque 3 milliards de personnes consomment moins d’électricité annuellement qu’un réfrigérateur américain moyen. Les combustibles fossiles sont le moyen le plus efficace de fournir l’énergie fiable et abordable dont ces personnes ont besoin pour améliorer leur sort, et donc toute restriction sur ces combustibles entrave immoralement leur développement. En bref, la décarbonisation est un luxe inabordable pour la plupart des gens. Ils sont confrontés à des problèmes bien plus immédiats, tangibles et solubles, que le risque de certains impacts climatiques futurs, que l’on peut au mieux résumer ainsi : « nous ne savons pas quoi, nous ne savons pas quand, et nous ne savons pas l’ampleur ».

D’exhorter, de cajoler et de demander au monde en développement de renoncer aux combustibles fossiles, comme l’ont fait la Banque mondiale et d’autres financiers, va directement à l’encontre de l’épanouissement de l’humanité. C’est comme dire à une personne affamée : « Ne mangez pas ce steak parce qu’il risque d’augmenter votre cholestérol ».
Une objection courante à cet argument est que la décarbonisation présente d’autres avantages – par exemple la réduction de la pollution atmosphérique locale. Mais prenons le cas de la Chine, où l’espérance de vie a augmenté de 10 ans entre 1980 et 2020, alors même que l’utilisation des combustibles fossiles a augmenté de 700 %. (Cela s’explique en partie par la réduction de la pollution à l’intérieur des habitations grâce à des combustibles de cuisson plus propres comme le GPL, un combustible fossile). Même les usines de charbon chinoises polluantes ont eu des retombées positives importantes, car la plupart des Chinois attachent beaucoup plus d’importance à l’augmentation de la disponibilité de l’énergie que pour l’assainissement de l’air.
Enfin, en comptabilisant les coûts et les bénéfices globaux, il faut également inclure les bénéfices de l’augmentation des niveaux de CO2 – même si cela est difficile à croire pour certains. L’un de ces avantages est que les décès dus à des températures extrêmes ont diminué au cours des dernières décennies, étant donné qu’environ 10 fois plus de personnes meurent de froid extrême (qui est en baisse) que de vagues de chaleur (qui augmentent modestement). Un autre avantage est que la terre s’est considérablement « reverdie » : selon une évaluation, la terre est 40 % plus verte qu’elle ne l’était il y a 40 ans. Cette tendance a également permis à la productivité agricole de monter en flèche, car les plantes « mangent » le CO2.
En fin de compte, la plupart des scientifiques savent, et un nombre croissant d’entre eux sont enfin prêts (courageusement) à reconnaître publiquement qu’il n’y a pas d’urgence climatique ni de crise climatique. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à la décarbonisation précipitée et universelle préconisée par les accords de Paris. Ce type de transition énergétique sera (en fait, ça l’est déjà) perturbateur et coûteux. En fait, la plupart des pays émergents disent, à juste titre, « nous ne le ferons pas, à moins que vous nous payiez pour cela ». Et nous, dans le monde développé, n’avons pas l’argent nécessaire pour le faire.
Quel est le coût de l’assurance ?
La volonté des citoyens et des hommes politiques d’« acheter » une assurance climatique se réduit à une évaluation technologique de l’éventail des systèmes énergétiques proposés et, surtout, de ceux qui peuvent fonctionner à l’échelle de la société. Il ne s’agit donc pas tant de faire des prévisions, comme c’est le cas pour la science du climat, mais plutôt d’évaluer le coût de construction et d’exploitation d’équipements sur la base de divers scénarios technologiques.
De nos jours, nous avons tendance à être captivés par les technologies ambitieuses, les systèmes n’ayant pas encore fait leurs preuves, et, en termes de médias sociaux, par les « clickbait » (appâts à clics) avec des titres à couper le souffle sur les prétendues « percées ». En réalité, les systèmes à l’échelle industrielle quels qu’ils soient, pouvant être construits dans un avenir immédiat, utilisent des technologies que l’on sait déjà construire, qui ont été inventées il y a des années et qui sont maintenant à maturité, avec des chaînes d’approvisionnement viables. Et pour les calculs (et non les prévisions) des coûts, il existe de nombreuses données solides et fiables sur les équipements et les systèmes que nous savons construire.
Il y a de bonnes raisons d’investir dans la R&D pour identifier des technologies énergétiques supérieures. Mais cela n’a aucun rapport avec l’estimation des coûts de la politique d’assurance actuellement envisagée, car, encore une fois, ce qui peut être déployé à grande échelle d’ici à une dizaine d’années, c’est ce que nous savons déjà construire, qu’il s’agisse d’éoliennes ou de turbines à gaz.
Nous disposons de données qui clarifient les coûts réels de la décarbonisation, sur une période similaire à celle envisagée par les défenseurs du climat. L’année 2000 se situe à la même distance dans notre passé que la date cible de 2050 dans notre avenir. Depuis l’an 2000, les États-Unis et l’Europe ont dépensé plus de 10 000 milliards de dollars pour éviter, remplacer ou minimiser l’utilisation d’hydrocarbures. Ces efforts ont permis de réduire la part des hydrocarbures dans l’énergie mondiale, mais seulement d’environ trois points de pourcentage, pour atteindre le niveau actuel d’un peu plus de 81 %. En termes absolus, l’utilisation du pétrole, du gaz naturel et du charbon a partout augmenté, collectivement, d’une quantité équivalente à l’ajout de six Arabie Séoudite à la production pétrolière. De même, une décennie de subventions destinées aux véhicules électriques a conduit à la mise en circulation de quelque 40 millions de véhicules électriques dans le monde. Sans doute que ces véhicules déplacent du pétrole qui aurait été utilisé autrement. Mais la consommation absolue d’essence a tout de même augmenté et atteint aujourd’hui un niveau record.
Si le fait de dépenser 10 000 milliards de dollars n’entraîne pas de décarbonisation significative, que faudrait-il faire ?
Sur la base de cette expérience récente, et même en supposant que les technologies privilégiées soient, du jour au lendemain, disons 50 % moins chères – ce qui n’est pas le cas – la réduction de la part des hydrocarbures dans l’énergie, à un peu moins de la moitié de la demande totale en 2050 représente quelque chose entre 100 000 à 300 000 milliards de dollars. C’est environ cinq à quinze fois le capital qui serait nécessaire pour répondre à la demande, en utilisant l’énergie conventionnelle. Et même dans ce cas, cette part réduite d’hydrocarbures en 2050 serait toujours, en termes absolus, à peu près la même quantité utilisée qu’aujourd’hui, en raison de l’augmentation future de la demande d’énergie.
Tout cela suppose que les coûts du solaire, de l’éolien et des batteries seront radicalement inférieurs à l’avenir, une affirmation qui n’est pas étayée par la réalité. L’augmentation des coûts n’est pas due aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement provoquées par les confinements dus au Covid, mais elle est ancrée dans un fait inévitable : il faut beaucoup plus de métaux et de minéraux pour construire les machines à énergie dite « vertes » que pour construire les machines à hydrocarbures. Une analyse de fond de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) a révélé qu’une décarbonisation partielle nécessiterait des augmentations fantastiques de l’exploitation minière mondiale, allant d’un quadruplement à 40 fois, par rapport à aujourd’hui, selon le minéral. D’autres recherches révèlent des écarts plus importants : un récent article de Yale a déterminé que l’exploitation minière mondiale devrait être multipliée de 60 à 300 fois, selon le minéral.
Cela met en évidence un problème fondamental : la création d’une nouvelle mine prend en moyenne 15 ans. Pour les planificateurs « d’assurance », l’industrie minière mondiale n’a pas l’intention d’exploiter de telles quantités. Même si l’on partait du principe que l’argent et les mandats pourraient raccourcir le délai de construction de nouvelles mines à une décennie, il n’y aurait toujours pas de moyen arithmétique pour répondre à la demande croissante de minerai pour construire l’équipement nécessaire à la décarbonisation.
Les décarbonistes répondent, à juste titre, que les forces du marché résoudront ce problème. C’est vrai, mais pas comme ils l’imaginent. L’effet d’une demande étonnamment supérieure à l’offre sera une escalade inflationniste stupéfiante des prix – c’est-à-dire une destruction de la demande. Cela affectera tous les marchés, car les mêmes minéraux sont utilisés partout. Mais pour les machines énergétiques, les matériaux entrants représentent entre 30 et 50 % du coût de fabrication des modules solaires et de 50 à 70 % du coût d’une batterie de véhicule électrique. En bref, les coûts de production des machines vertes vont augmenter, et pas diminuer. Ce décalage dans la réalité des matériaux est complètement ignoré dans les prévisions. Il s’agit d’un fossé qui ne peut être comblé par des discours sur le recyclage, qui, au mieux, ne peuvent que modérer légèrement la croissance de la demande nette.
L’Allemagne constitue également une autre source de données macroéconomiques concernant les coûts de la décarbonisation dans le monde réel. Au cours des deux dernières décennies, l’Allemagne a grosso modo doublé la capacité totale de son réseau électrique, principalement en construisant des centrales solaires et des éoliennes, mais par nécessité, elle a conservé environ 80 % du réseau d’origine. (La majeure partie de la réduction est due à la fermeture inconsidérée de centrales nucléaires). Pendant ce temps, la demande totale d’électricité en Allemagne a augmenté de moins de 10 %. Cette déconnexion a eu un impact économique : Les tarifs de l’électricité en Allemagne ont presque triplé. Cela a non seulement accru la pauvreté énergétique en Allemagne, mais a également rendu le pays fragile sur le plan énergétique, un prélude aux conséquences désastreuses de la perte du gaz naturel russe à prix réduit lors de la guerre d’Ukraine. Si la solution à ce problème avait été de construire plus d’éoliennes et de panneaux solaires, l’Allemagne l’aurait fait. Au lieu de cela, elle a fait marche arrière et a construit des capacités massives d’importation de GNL. Mais ce virage de 180 degrés était trop peu et trop tard, car l’Allemagne connaît aujourd’hui une désindustrialisation catastrophique, en grande partie à cause du coût élevé de l’énergie. Pendant ce temps, aux États-Unis, les prix en gros des projets solaires et éoliens à grande échelle ont doublé au cours de la dernière demi-douzaine d’années. Les coûts réels de l’énergie solaire et éolienne « trop bon marché pour être mesurés » montent en flèche.

À l’échelle de la société, l’expérience a démenti les affirmations selon lesquelles le solaire et l’éoliene, en particulier lorsqu’ils sont associés à des batteries de stockage à grande échelle, soient intrinsèquement moins chers, basés sur le coût du cycle de vie. Si c’était vrai, les décarbonistes des entreprises de centres de données couperaient complètement le cordon électrique et construiraient de telles solutions pour répondre aux demandes d’électricité, devenues désormais évidentes et gigantesques, de l’économie numérique. Ce n’est pas le cas. Et l’achat et la rénovation de vieilles centrales nucléaires est une option limitée et ponctuelle.
Ces augmentations de coûts sont distinctes des impacts inflationnistes, si le gouvernement américain dépense les fonds alloués et subventionnés par la loi sur la réduction de l’inflation (IRA), qui est, une fois de plus, une dépense énergétique non déguisée. Le coût total réel de l’IRA, s’il est finalement et pleinement mis en œuvre, a été estimé entre 2 000 et 3 000 milliards de dollars. À titre de comparaison, cela équivaut aux 4 000 milliards de dollars (corrigés pour l’inflation) que les États-Unis ont dépensés pour la Seconde Guerre mondiale.
Les dépenses inflationnistes de l’IRA n’incluent pas les autres dépenses énergétiques en cours et prévues dans environ deux douzaines d’États qui se sont engagées à suivre les plans agressifs de décarbonisation de la Californie. Cela ne tient pas compte, non plus, du fait, que les mandats concernant uniquement les véhicules électriques inciteront les compagnies d’électricité à dépenser 3 000 milliards de dollars supplémentaires pour développer l’infrastructure de distribution du réseau. Le coût des centrales électriques supplémentaires nécessaires à la production d’électricité n’est pas non plus pris en compte. Les contribuables devraient s’inquiéter, notamment parce que des dépenses aussi rapides créent d’énormes possibilités de gaspillage, de fraude et de corruption.
On pourra peut-être comprendre l’ampleur des dépenses, à travers un objectif plus spécifique: une analyse réalisée par le National Bureau of Economic Research (NBER). L’équipe du NBER s’est plongée dans les interstices de l’IRA et a découvert que les subventions aux véhicules électriques (VE) totalisent à elles seules entre 23 000 et 32 000 dollars pour chaque véhicule. Il s’agit d’un véritable subventionnement à l’échelle de la Chine.
Si les décarbonistes prenaient au sérieux la question du rapport coût-efficacité, ils se concentreraient davantage sur les subventions destinées à encourager l’achat de moteurs à combustion plus efficaces, par exemple. Selon les propres estimations de l’AIE, une telle politique réduirait la consommation mondiale de pétrole davantage que ne le ferait une multiplication par près de sept fois le nombre de VEs dans le monde.
Que devrions-nous vraiment faire pour le climat ?
Un examen objectif des tendances démographiques, du développement économique et des technologies énergétiques montre qu’il serait extrêmement difficile, voire impossible, de parvenir à une zéro émission nette d’ici à la fin du siècle. En même temps, un examen impartial des conséquences de manquer l’objectif arbitraire de Paris ne révèle pas de catastrophe. Cela ne signifie pas que le monde, ou les États-Unis, ne devraient rien faire.
Voici ce que nous devrions faire.
Tout d’abord, nous devons soutenir et améliorer la science du climat, car nos connaissances sont très lacunaires. Les études paléoclimatiques nous indiquent comment et pourquoi le climat a changé dans le passé ; les observations actuelles, dont la couverture, la précision et la continuité ont été améliorées, nous indiquent ce que fait le système climatique aujourd’hui, et les modèles nous donnent une idée de ce qui pourrait se produire à l’avenir. Mais il est urgent de renforcer la rigueur statistique des analyses et de mieux cibler les efforts de modélisation pour réduire les incertitudes.
Deuxièmement, nous devons améliorer la communication publique, car il y a beaucoup trop de « fake news » (fausses informations) sur le climat. Nous devons mettre fin à la rhétorique de la « crise climatique », tout en reconnaissant que les influences humaines sur le climat sont réelles et que nous devrions réfléchir à ce qu’il convient de faire à long terme et de manière ordonnée. Le public doit avoir une vision précise du climat et de l’énergie et aller au-delà de slogans tels que « Nous sommes sur l’autoroute de l’enfer climatique avec le pied sur l’accélérateur ». Les non-spécialistes sont suffisamment avisés pour rejeter les histoires de peur hyperboliques ; ceux qui se livrent à un tel sensationnalisme contribuent à l’érosion générale de la crédibilité scientifique.
Troisièmement, nous devons reconnaître que la fiabilité et l’accessibilité de l’énergie passent avant la réduction des émissions. Un bon début est d’admettre que le pétrole et le gaz seront nécessaires dans un avenir prévisible. La crise énergétique actuelle de l’Europe est auto-infligée ; les investissements dans les combustibles fossiles et la production nationale ont été abandonnés en faveur d’importations peu fiables et d’une production peu fiable à partir de l’énergie éolienne et solaire. Il était facile de voir que cela mènerait à des problèmes, et beaucoup l’avaient prédit, mais la décarbonisation a néanmoins été privilégiée par rapport à la fiabilité et à l’accessibilité financière.
Quatrièmement, les gouvernements doivent s’engager dans des programmes de transition énergétique réfléchis et élégants, qui intègrent la technologie, l’économie, la réglementation et le comportement, et qui évaluent les coûts, les délais et les impacts réels sur le climat. Pour réduire ce que l’on appelle la prime verte, un élément essentiel de la réflexion est la nécessité d’intensifier la recherche et le développement pour aboutir à des démonstrations, au lieu d’un déploiement prématuré de technologies énergétiques plus récentes. La fission à petite échelle, le stockage et la gestion de réseaux à faible coût, les combustibles chimiques sans carbone, ainsi que le captage et le stockage du carbone font tous partie d’une liste raisonnable d’idées prometteuses, mais sont toutes aujourd’hui à des stades très précoces et non commerciaux.
L’énergie est fournie à l’échelle de la société par des systèmes complexes qui touchent à –pour reprendre le titre d’un film – « Tout, partout, tout à la fois ». Il est préférable de modifier lentement ces systèmes. Des actions précipitées visant à remodeler l’ensemble du système énergétique sont bien plus perturbatrices que n’importe quel impact plausible du changement climatique. Il est scandaleux que les États-Unis prévoient de dépenser des milliers de milliards de dollars pour déployer des technologies énergétiques peu fiables, alors que nous avons tant d’autres besoins tangibles et solvables, notamment en matière de soins de santé, d’infrastructures et d’éducation.
Cinquièmement, les pays développés doivent reconnaître qu’il est inévitable, voire souhaitable, de répondre aux besoins énergétiques des pays en développement. La majeure partie du monde manque aujourd’hui d’énergie et les combustibles fossiles sont le seul moyen viable de répondre à cette demande ; ils fournissent plus de 80 % de l’énergie mondiale aujourd’hui, comme ils l’ont fait pendant de nombreuses décennies. Sans systèmes de secours coûteux, la production éolienne et solaire dépendante des conditions météorologiques ne peut pas fournir un accès approprié à l’énergie pour ces personnes. Les partisans d’une décarbonisation rapide à l’échelle mondiale se livrent à des élucubrations faciles sur la manière de répondre aux besoins énergétiques des pays en développement.
Les décideurs politiques doivent se concentrer davantage sur des stratégies alternatives pour faire face aux conséquences futures hypothétiques d’un climat changeant. Le plus important, c’est l’adaptation. L’adaptation est autonome – c’est ce que font les humains. Elle est efficace, proportionnelle et intrinsèquement locale et réalisable.
Que pouvons-nous vraiment faire pour changer le paysage énergétique ?
En ce qui concerne les technologies et les politiques énergétiques, nous devons reconnaître trois tendances fondamentales à long terme, que certains décideurs politiques tentent d’infléchir avec de l’argent.
Premièrement : la mesure de l’efficacité. Les ingénieurs chercheront toujours à améliorer l’efficacité ; c’est inhérent au progrès. Ainsi, nous constatons que la mesure populaire du mérite – la consommation d’énergie par unité de production économique – s’est continuellement améliorée. Mais cela n’a pas réduit la consommation globale d’énergie. La réalité à long terme d’une plus grande efficacité stimulant une plus grande demande a été documentée pour la première fois au milieu du XIXe siècle par l’économiste britannique William Stanley Jevons ; c’est ce que l’on appelle aujourd’hui le « paradoxe de Jevon ». Jevons lui-même a écrit à l’époque que, pour l’observateur occasionnel, cela « semblait un paradoxe », mais il a noté, explicitement, que le résultat d’une plus grande efficacité était de réduire les coûts et donc de stimuler la demande.
La deuxième tendance à long terme est que les sociétés privées d’énergie voient leur consommation d’énergie par habitant augmenter continuellement à mesure que leur richesse s’accroît – ce qui est une caractéristique inévitable et souhaitable du progrès technologique. Robert Solow a reçu le prix Nobel d’économie en 1987 pour ses travaux montrant que « la technologie reste le principal moteur de la croissance ». Et la croissance elle-même est stimulée dans une large mesure par la disponibilité d’une plus grande efficacité énergétique, car toutes les technologies utilisent nécessairement de l’énergie. Le progrès technologique stimule donc, de manière symbiotique, à la fois l’efficacité énergétique et la demande d’énergie.
La troisième tendance à long terme est inébranlable et varie étonnamment peu : il s’agit de la décarbonisation progressive, sur plusieurs siècles, de l’ensemble de l’approvisionnement en énergie primaire de la civilisation. Cette tendance se poursuivra d’elle-même.
Ces rythmes naturels à long terme de la civilisation ont ce que l’on peut appeler une forte inertie. En général, les sociétés ne sont pas disposées à dépenser, ou ne se révèlent probablement pas capables de dépenser, les capitaux nécessaires pour faire dévier ces tendances de leur cours naturel.
Nombreux sont ceux qui sont convaincus, à juste titre, qu’il doit exister de meilleures technologies énergétiques que celles dont nous disposons aujourd’hui. La question n’est pas de savoir si, mais quand ces technologies pourront apparaître comme pratiques et à grande échelle. L’histoire nous a appris que des changements fondamentaux dans le domaine de la science – ainsi que des changements révolutionnaires dans le domaine de la technologie – se produisent. Mais ils présentent une caractéristique gênante, que Bill Gates a décrite comme l’absence d’une « fonction prédictive ».
Pour aujourd’hui et les prochaines décennies, l’essentiel, c’est que si nous voulons des révolutions énergétiques, une société stable et une croissance économique, nous devrions cesser de gaspiller des capitaux précieux dans des technologies d’hier – et, franchement, dans des kleptocrates. Les types de révolutions technologiques énergétiques que nous pensons tous être un jour possibles, voire probables, requièrent une chose qui fait défaut dans les domaines politiques : la patience. Les promesses de réacteurs à fission radicalement nouveaux, voire de microréacteurs à l’échelle d’un centre de données, et de nouveaux matériaux énergétiques quasi magiques comme le graphène, sont alléchantes. L’objectif insaisissable de la fusion pratique se réalisera un jour. Il y aura aussi une nouvelle physique, un jour. Si nous voulons plus de magie fondamentale, nous devrons avoir la patience de nous concentrer sur la réanimation de la recherche fondamentale ouverte.
En attendant, la civilisation a besoin d’énormes quantités d’énergie à faible coût, et elle en a besoin, venant de technologies et de systèmes que nous savons construire aujourd’hui. Les ingénieurs, les entrepreneurs et les entreprises peuvent relever ce défi, mais principalement en utilisant des hydrocarbures.
Steven E. Koonin est Senior Fellow à la Hoover Institution, conseiller au “National Center on Energy Analytics” et auteur de “Unsettled : What Climate Science Tells Us, and What It Doesn’t, and Why It Matters.” Mark P. Mills est directeur exécutif et fondateur du “National Center on Energy Analytics” et auteur de “The Cloud Revolution : How the Convergence of New Technologies Will Unleash the Next Economic Boom and a Roaring 2020s.”
more news
Clintel Ambassador Ian Plimer on popular Triggernometry podcast: “Climate science is the biggest cult in scientific history”
Clintel-ambassador for Australia, prof. Ian Plimer, didn’t hold back in his recent interview on the popular Triggernometry podcast: “There’s a very large body of people out there who are actually using science to promote scams. It’s absolutely crippling Western countries. You can’t run an industrial society on sea breezes and sunbeams.”
Groundbreaking New Paper Challenges Foundation of Climate Change Assessments, Revealing Fatal Flaws in Ocean Heat Content Measurements
An international team of scientists has published groundbreaking research revealing that the primary measurement used to support claims of planetary “warming” is fundamentally flawed and scientifically invalid.
The Frontier of Climate Science: Solar Variability, Natural Cycles and Model Uncertainty
Climate scientist Nicola Scafetta has published a new book examining the complex interplay between solar variability, natural climate cycles, and the limits of current climate models. The Frontier of Climate Science explores how natural variability, observational uncertainties, and model limitations shape our understanding of past and future climate change.